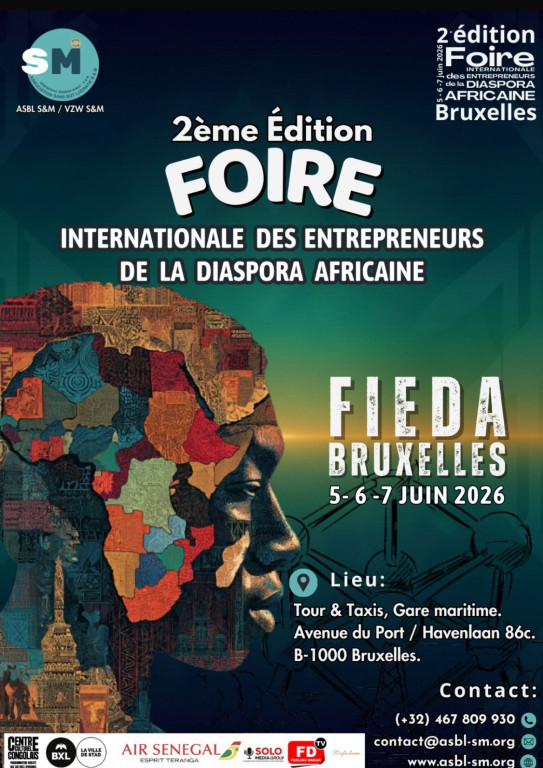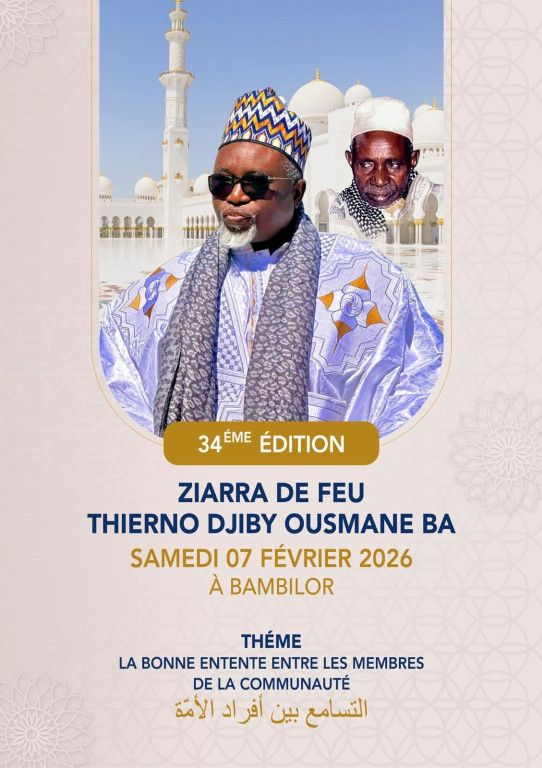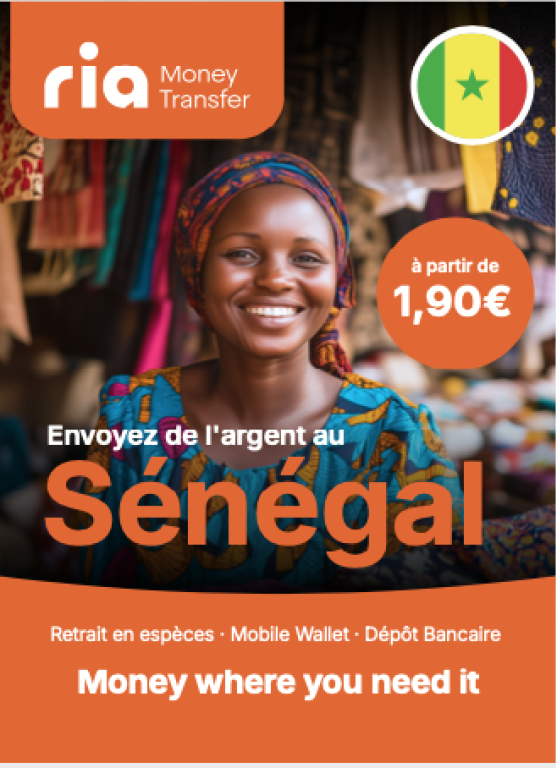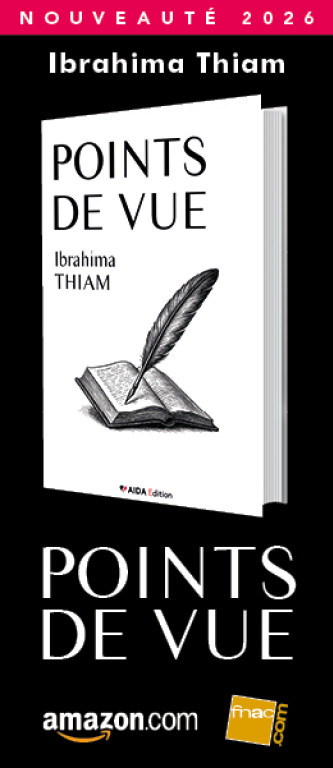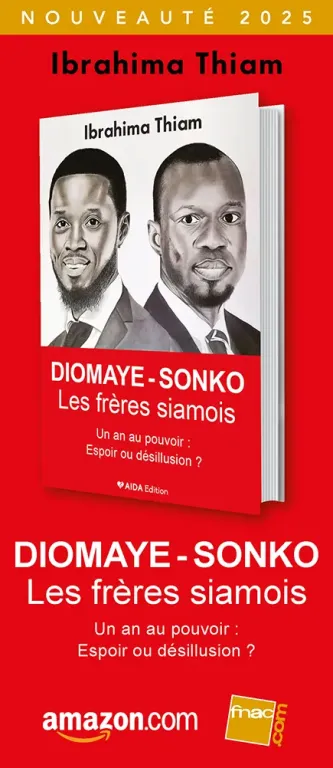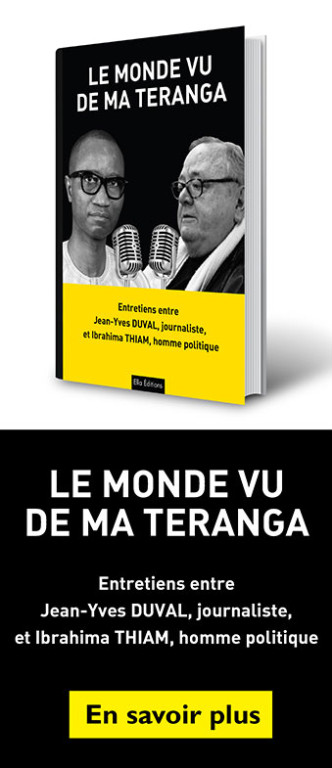Quand la rente s’effondre : l’économie politique des médias sénégalais face à la convergence anticipatoire
L’histoire de la presse sénégalaise s’écrit toujours à la frontière mouvante entre la liberté proclamée et la dépendance structurelle. À chaque régime, une tension s’installe entre l’exigence d’informer et la réalité des mécanismes de survie économique qui, souvent, dictent les lignes éditoriales. La conjoncture politique actuelle impose un enjeu nouveau : l’asphyxie économique des organes de presse n’est pas seulement conjoncturelle, elle est structurellement orchestrée, comme si l’étouffement d’un écosystème bâti sur des logiques prébendières devait être la condition d’émergence d’un nouvel ordre médiatique. Le paradigme est celui de la convergence anticipatoire : ce qui fut hier une presse arrimée à des rentes d’État et de réseaux est aujourd’hui confronté à l’inévitabilité d’un réagencement global, porté autant par les mutations technologiques que par la massification d’une presse citoyenne et la recomposition des espaces publics numériques.
L’économie politique des médias permet de comprendre cette dynamique en articulant les relations entre pouvoir politique, ressources économiques et production symbolique. Pendant des décennies, la presse sénégalaise a fonctionné sur un modèle ambigu, où la rente étatique – subventions, marchés publicitaires liés à l’administration, contrats opaques – garantissait une survie minimale tout en instaurant une forme de dépendance. Ce modèle n’était pas un accident mais une stratégie : la presse devenait ainsi une extension du champ politique, encadrée par une économie du privilège. Dans un contexte marqué par la faiblesse structurelle du marché publicitaire et par l’absence de mécanismes solides de financement indépendant, cette dépendance façonnait les pratiques éditoriales : prudence dans la critique, alignement sur certains intérêts, marchandage de silence ou de visibilité. Les médias se trouvaient piégés dans une logique où la raison journalistique était constamment mise en balance avec la raison prébendière.
Or, la configuration politique actuelle renverse cette équation. L’État n’apparaît plus comme un distributeur automatique de rentes. La volonté de couper les circuits de financement implicites et de démanteler les structures de dépendance s’inscrit dans une logique de rupture. Ce démantèlement n’est pas seulement une décision politique, il est une nécessité historique : l’écosystème médiatique issu des régimes précédents est devenu obsolète face aux nouvelles dynamiques de production et de circulation de l’information. L’ère du cyberespace, la fluidité des plateformes sociales et l’émergence d’une presse citoyenne de masse redéfinissent les modalités de la légitimité médiatique. Là où hier la reconnaissance passait par la possession d’un journal, d’une radio ou d’une télévision, elle passe désormais par la capacité à occuper et structurer les flux numériques. La valeur médiatique ne réside plus dans la détention d’une imprimerie ou d’une fréquence hertzienne mais dans la résonance cognitive et symbolique au sein des réseaux sociaux globalisés.
L’analyse diachronique révèle ainsi une tension constante : dans l’ancien régime, la presse, malgré ses proclamations d’indépendance, évoluait dans un régime de cohabitation avec le pouvoir politique, souvent sous la forme d’un contrat implicite : protection contre allégeance, financement contre silence, visibilité contre orientation. Les rédactions fonctionnaient avec cette conscience tacite que leur survie dépendait moins de leur lectorat que de leur proximité avec les cercles de pouvoir. Les grands groupes médiatiques sont nés et ont prospéré sous ce régime d’exception, où la liberté formelle d’expression masquait une dépendance matérielle. Cette économie du privilège ne pouvait durer qu’aussi longtemps que les rentes d’État étaient soutenues. Mais la convergence anticipatoire nous invite à lire au-delà de cette contingence : elle nous montre que le déclin de ce modèle était inscrit dans les logiques mêmes de transformation de la communication contemporaine.
Car ce qui s’annonce n’est pas seulement une crise de financement : c’est une reconfiguration paradigmatique. Les technologies sociales – réseaux sociaux, plateformes participatives, écosystèmes numériques de diffusion – produisent une presse citoyenne qui déstabilise les hiérarchies traditionnelles. Le monopole de l’information se dissout dans la multitude. Les organes de presse traditionnels perdent leur centralité, car l’agenda public est désormais structuré par les flux numériques. Les logiques virales supplantent les logiques éditoriales classiques, les micro-influenceurs concurrencent les éditorialistes établis, les communautés numériques définissent des narratifs collectifs sans passer par la médiation institutionnelle des rédactions. Cette mutation n’est pas seulement technique, elle est sociologique : elle traduit une redistribution du pouvoir symbolique. Là où l’ancien régime médiatique imposait une verticalité – du journaliste vers le citoyen –, le nouveau modèle instaure une horizontalité des interactions et une polyphonie des récits.
La posture éditoriale des organes hérités de l’ancien régime devient alors leur propre piège. En s’étant habitués à la rente, ils ont négligé d’investir dans des modèles alternatifs de financement, de diversification et d’innovation. Leurs stratégies de survie reposaient sur la continuité d’un système prébendier, sans anticiper la fragilisation des appuis politiques et la montée en puissance des acteurs citoyens. Cette absence d’anticipation est fatale : dans une logique de convergence anticipatoire, ce qui s’impose n’est pas ce qui fut, mais ce qui advient inévitablement. Et ce qui advient, c’est un espace médiatique où l’autorité éditoriale ne peut plus être imposée par le pouvoir économique ou politique mais doit être conquise par la pertinence, la résonance et la confiance sociale.
Il faut ainsi comprendre l’actuelle asphyxie économique des organes de presse non comme une crise passagère mais comme un moment de bascule historique. L’économie politique des médias nous enseigne que les structures de financement déterminent en grande partie les contenus et les orientations éditoriales. La fin des rentes d’État marque donc une rupture : elle ouvre la possibilité d’une presse réellement indépendante, mais elle condamne aussi ceux qui, habitués aux prébendes, ne savent penser leur avenir autrement que par la dépendance. Le paradoxe est là : l’étranglement économique, loin d’être uniquement une sanction, est aussi une opportunité de réinvention. Ceux qui sauront rompre avec les réflexes anciens, développer des modèles économiques basés sur la valeur ajoutée, l’innovation numérique, les abonnements citoyens, le crowdfunding, ou les coopératives médiatiques, seront les survivants et les pionniers de la nouvelle ère. Les autres seront relégués au statut de reliques d’une époque révolue.
L’émergence de la presse citoyenne accentue cette mutation. Non seulement elle occupe l’espace discursif, mais elle impose de nouvelles normes : immédiateté, interaction, transparence. Le citoyen-journaliste, équipé d’un smartphone et d’un compte sur une plateforme globale, concurrence directement les reporters traditionnels. Ce déplacement est irréversible. Il transforme la fonction même du journalisme, désormais moins centrée sur la transmission d’informations brutes que sur la capacité à donner sens, à contextualiser, à interpréter. Dans ce nouvel écosystème, la légitimité ne peut plus être achetée par des contrats publicitaires d’État : elle se conquiert par la confiance et l’engagement des publics. C’est là que se joue la véritable révolution : l’économie de la confiance remplace l’économie de la rente.
La convergence anticipatoire, appliquée à la presse sénégalaise, révèle donc la continuité d’un processus : la prébende médiatique, produit de l’ancien régime, portait en elle-même les germes de son effondrement. Son incompatibilité avec les logiques numériques et citoyennes actuelles rendait inévitable sa disparition. L’histoire médiatique du Sénégal entre ainsi dans une phase nouvelle où le démantèlement des structures anciennes n’est pas une tragédie mais une nécessité historique. Il ne s’agit pas seulement d’une crise économique, mais d’une réinitialisation du rapport entre médias, société et pouvoir. L’avenir appartiendra aux organes qui auront compris que la véritable richesse médiatique ne réside pas dans la proximité avec les cercles de pouvoir, mais dans la capacité à anticiper, à s’adapter et à tisser des liens authentiques avec les communautés citoyennes.
Ce basculement exige une prise de conscience radicale : la presse sénégalaise ne peut survivre qu’en devenant autre. En intégrant les logiques numériques, en se réinventant comme espace de médiation, en valorisant la pluralité des voix citoyennes, en refusant la facilité des rentes et en embrassant la difficulté mais aussi la dignité de l’indépendance économique. Ce qui s’impose, en définitive, est la fin d’une époque et l’avènement d’une presse qui, libérée de la prébende, devra se réinventer dans le tumulte de la société numérique et dans le sillage de la convergence anticipatoire. L’histoire ne lui laisse pas d’autre choix.
Mais pour bien saisir l’ampleur de cette mutation, il faut la comparer à d’autres expériences africaines. Le Nigeria, par exemple, a vu émerger une presse en ligne puissante qui contourne les difficultés des médias traditionnels et capte directement des audiences massives grâce à des plateformes numériques comme Sahara Reporters. En Afrique du Sud, l’écosystème médiatique, bien que plus ancien et plus diversifié, a également dû s’adapter à une économie numérique qui fragmente les publics et impose de nouvelles formes de financement. Le Kenya, avec son fort taux de pénétration mobile et ses plateformes numériques de paiement, a développé des modèles hybrides où l’abonnement digital et le micro-paiement permettent de maintenir des rédactions indépendantes. Ces exemples montrent que la reconfiguration n’est pas propre au Sénégal, mais qu’elle obéit à une logique continentale, voire globale : l’économie de la rente est partout menacée, et l’économie de l’innovation devient la règle.
Pourtant, le Sénégal se distingue par l’acuité de sa crise. La tradition démocratique et le pluralisme formel y ont longtemps masqué la dépendance économique. Mais le moment présent dévoile une vérité brutale : sans réinvention économique, la liberté éditoriale est illusoire. La sociologie du cyberespace éclaire ici le processus : dans les environnements numériques, la légitimité ne dépend pas seulement de l’institution mais de la capacité à générer de la confiance et à créer des communautés d’adhésion. Les organes de presse traditionnels, habitués à parler du haut de leur chaire, doivent désormais apprendre à dialoguer horizontalement avec des publics actifs, critiques et capables de produire eux-mêmes des récits concurrents.
Les modèles alternatifs existent pourtant : coopératives de journalistes financées par les lecteurs, abonnements numériques à faible coût, hybridations entre rédaction et plateforme citoyenne, partenariats avec des fondations internationales garantissant l’indépendance éditoriale, recours au mécénat citoyen via le crowdfunding. Ce sont des modèles encore fragiles, mais ils témoignent de la possibilité de construire une économie de la presse qui ne soit pas arrimée aux faveurs étatiques. Le défi est double : il s’agit d’assurer la viabilité financière tout en consolidant la crédibilité symbolique. Les rédactions qui sauront embrasser cette double exigence survivront. Les autres, engluées dans la nostalgie de la rente, disparaîtront.
Ainsi, le démantèlement de l’écosystème médiatique prébendier répond bien à une nécessité historique. La convergence anticipatoire nous invite à comprendre cette mutation comme l’aboutissement d’un processus inscrit dans la logique des transformations sociales, technologiques et politiques. Ce qui s’impose aujourd’hui n’est pas une catastrophe, mais une renaissance possible : celle d’une presse qui, délivrée de la tutelle des rentes, retrouve la noblesse de sa mission première, informer librement et servir l’espace public.
Note sur l’auteur
Dr. Moussa Sarr est, entre autres, sociologue des communications, spécialiste des médias, des communications publiques et de la sociologie du cyberespace. Son expertise s’enracine dans une formation et une pratique académique rigoureuse. En 1997, il a été, pendant qu'il terminait sa maîtrise en communication publique au département des communications de l'Université Laval, assistant de Florient Sauvageau , professeur dans le dit département, figure de référence en économie politique des médias, ce qui lui a permis de développer une approche critique des rapports entre pouvoir, économie et production médiatique.
Depuis, il poursuit une réflexion approfondie sur les mutations de l’écosystème médiatique, mobilisant la théorie de la convergence anticipatoire pour analyser les transformations en cours. Ses travaux mettent en lumière les logiques de rupture et les perspectives d’avenir pour la presse, en conjuguant rigueur analytique et engagement pour une information libre et indépendante.
Dr. Moussa Sarr