Le Venezuela face à l’ombre impériale américaine: une réactualisation de la doctrine Monroe à l’ère des enjeux géopolitiques.
Les tensions entre Washington et Caracas atteignent un nouveau sommet. Les États-Unis pourraient-ils envisager une action militaire contre le régime de Nicolás Maduro, après des années de menaces ouvertes, notamment sous l’administration Trump ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que le contexte géopolitique mondial a profondément changé marqué par la lourde défaite de l’allié israélien face aux missiles hypersoniques iraniens en juin dernier et l’incapacité de l’OTAN à inverser le cours du conflit ukrainien face au rouleau compresseur russe depuis 2022 rendent incertain tout nouveau front pour Washington, surtout face à un Venezuela soutenu par la Chine, la Russie, l’Iran, Cuba et la Corée du Nord. Il faut également comprendre que le Venezuela ne se trouve pas dans la même situation que la Libye de Mouammar Kadhafi ou la Syrie de Bachar al-Assad, où les contestations internes et les pressions externes étaient beaucoup plus intenses. Par ailleurs, la Russie et la Chine ne sont désormais plus disposées à laisser les États-Unis et leurs alliés occidentaux déstabiliser des pays ou provoquer des instabilités régionales.
Deux siècles après son énoncé, le spectre de la doctrine Monroe plane toujours sur Caracas. Formulée en 1823 pour empêcher toute ingérence européenne dans les Amériques, la doctrine Monroe peut-être interprétée comme un instrument justifiant l’interventionnisme américain. Aujourd’hui, les déploiements militaires américains dans les Caraïbes, au large des côtes vénézuéliennes, ravivent les interrogations sur les véritables objectifs stratégiques de Washington. Selon le Département de la Défense, un dispositif militaire impressionnant à savoir un sous-marin nucléaire et le navire d’assaut amphibie USS Iwo Jima, avec à son bord plus de 4 500 soldats et des équipements capables de mener des opérations amphibies et des frappes de précision, est déployé. Officiellement, cette opération viserait à intensifier la lutte contre le narcotrafic, le Président Maduro étant accusé par Washington de diriger un « cartel » menaçant la stabilité régionale. Pour le gouvernement vénézuélien, il s’agit au contraire d’une provocation impérialiste et d’un prélude à une tentative de déstabilisation, voire de changement de régime.
La réponse de Caracas ne s’est pas fait attendre, car plus de 4,5 millions de membres de la milice bolivarienne ont été mobilisés, tandis que 15 000 soldats ont été déployés à la frontière avec la Colombie et dans les eaux territoriales, des patrouilles renforcées et appuyées par des drones. Cependant, on peut dire que le peuple vénézuélien a une forte éducation politique bolivarienne; c'est-à-dire des citoyens caractérisés par un nationalisme et un anti-américanisme très fort. Elle est également une idéologie qui fait référence à un ensemble de politiques inspirés par les idées de Simón Bolívar (1783-1830), le « Libertador » qui a lutté pour l’indépendance de plusieurs pays d’Amérique latine face à l’Espagne. C'est pourquoi la posture de Caracas s’inscrit dans la continuité idéologique de la Révolution bolivarienne initiée par Hugo Chávez dans les années 1990, qui avait nationalisé les secteurs stratégiques, en particulier le pétrole, et affirmé une politique étrangère farouchement anti-impérialiste. Pour Nicolás Maduro, chaque pression américaine est interprétée comme une nouvelle tentative de contrôle sur les ressources nationales et une remise en cause de la souveraineté du pays. C'est la doctrine militaire du hard power américain basée sur l'usage de la force pour soumettre un pays.
Sur la scène internationale, le Venezuela resserre ses liens avec des puissances rivales de Washington. Pékin, qui investit massivement dans le pays, a dénoncé toute ingérence étrangère. Moscou a, de son côté, renforcé sa coopération avec Caracas à travers un partenariat stratégique signé en mai 2025, couvrant l’énergie, la coopération militaire et la résistance aux sanctions occidentales. Ces alliances font du Venezuela non seulement un enjeu énergétique, mais aussi un point de friction majeur dans le bras de fer global qui oppose Washington à ses compétiteurs géopolitiques.
Dailleurs, au-delà des démonstrations militaires, Caracas subit une pression indirecte à savoir des sanctions économiques, des accusations de corruption ou de violations des droits humains, des tentatives de coup d’État comme l’« opération Gideon » en 2020 et soupçons de cyberattaques sur ses infrastructures électrique comme les grands blackouts en 2019 affectant l’ensemble du pays.
Au terme de notre analyse, on peut dire que si une confrontation militaire directe reste improbable à court terme, elle ne peut être totalement écartée. Washington semble privilégier une stratégie d’usure, combinant pressions économiques et isolement diplomatique, tandis que le régime Maduro mise sur la résilience populaire et sur l’appui de ses alliés. Le Venezuela s’impose ainsi comme l’un des théâtres les plus sensibles de la rivalité géopolitique contemporaine, où se mêlent enjeux énergétiques, rivalités idéologiques et stratégies de puissance.
Maodo Ba Doba
Historien militaire contemporain,
Professeur en Études stratégiques de défense et politiques de sécurité.








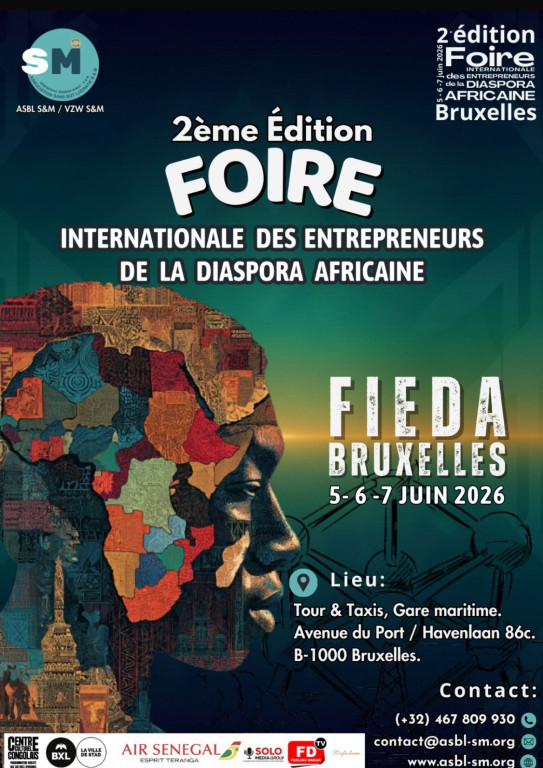

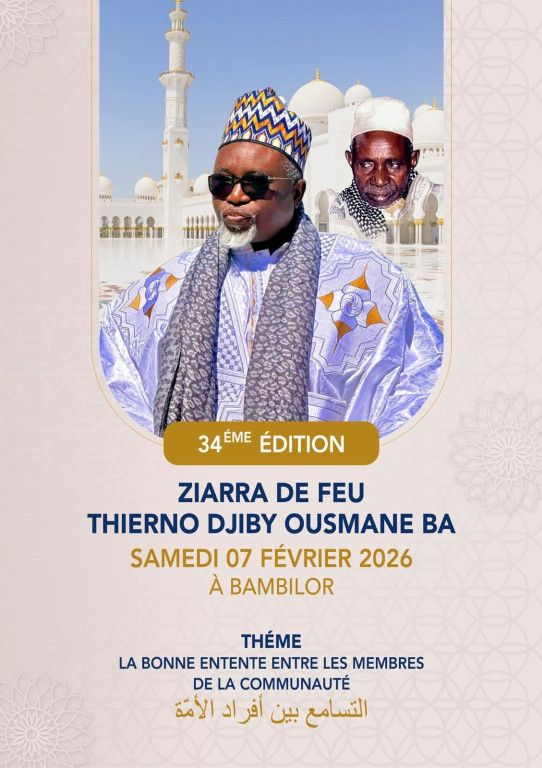
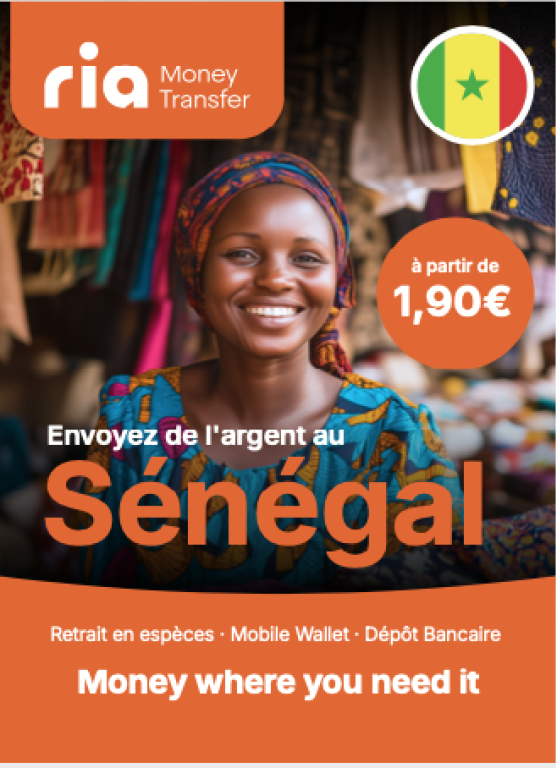


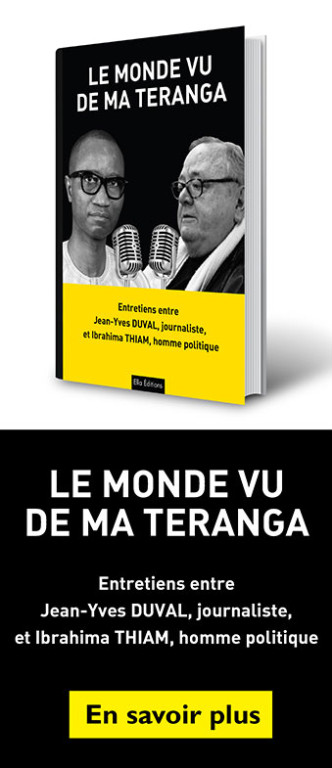

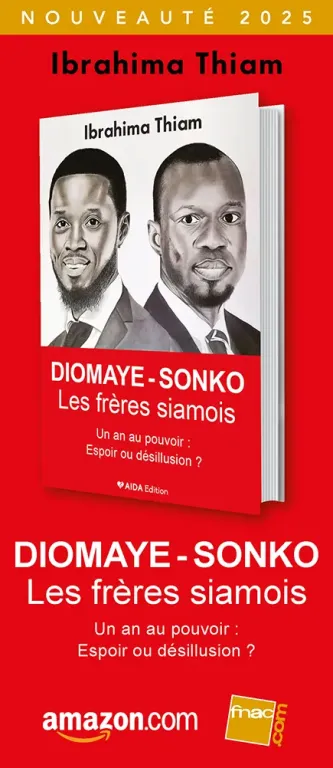
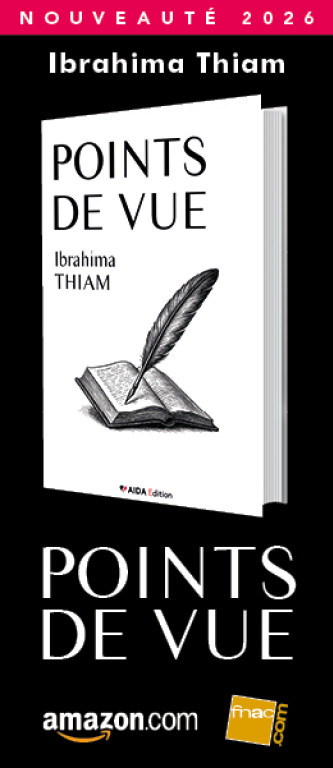
Mes respects