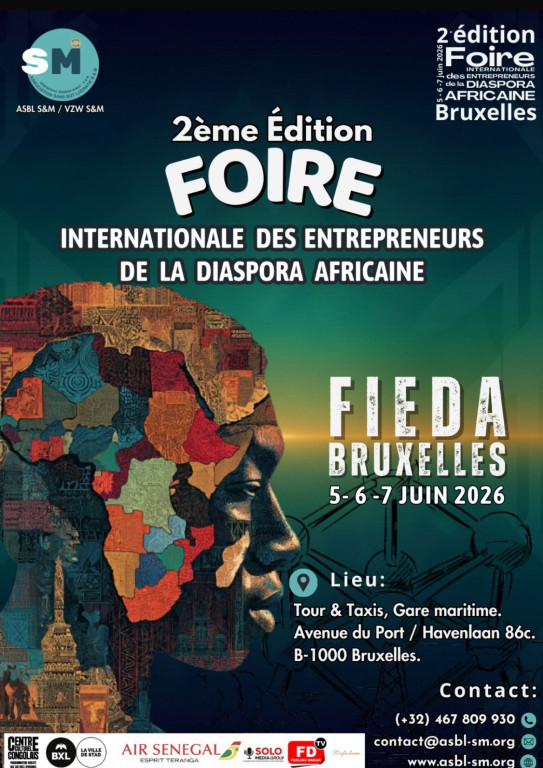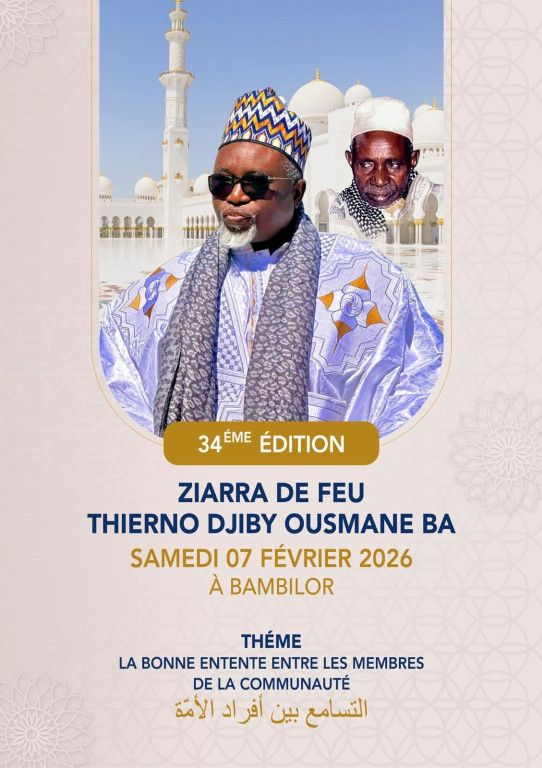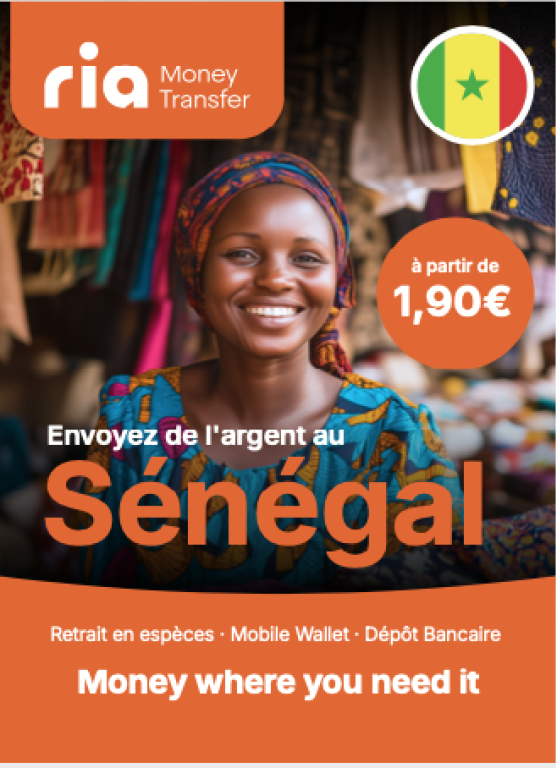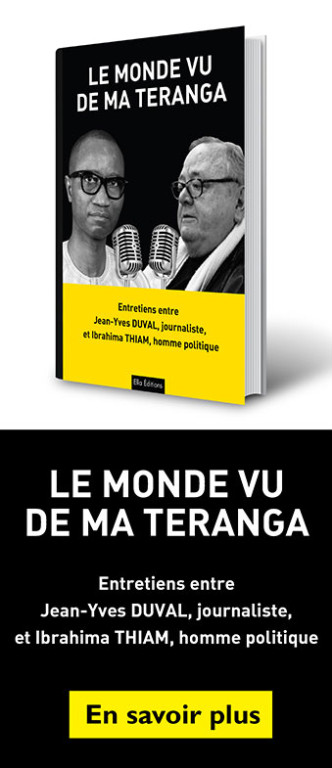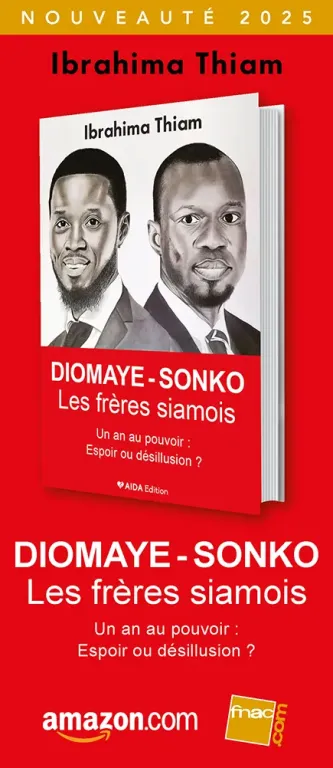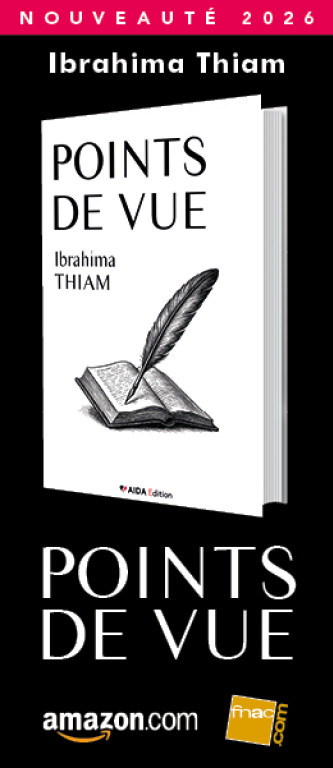Face à la crise soudanaise, beaucoup d’Africains s’interrogent sur la non-intervention de l'ONU.
Si les Africains se trompaient-ils en pensant que l'ONU est créée pour la sauvegarde de la paix mondiale?
Et si l'Afrique pensait-elle plus à une sécurité collective fondée sur la souveraineté des États pour garantir la paix continentale?
Alors que les massacres se poursuivent au Soudan dans le Darfour à El-Fasher surtout, une question revient avec insistance en Afrique: où sont les Nations unies? Nous nous demandons où étaient-elles lors de la guerre du Biafra entre 1967-1970 au Nigeria? Pendant les années sombres de l’apartheid en Afrique du Sud? Au Rwanda en 1994? Au Darfour entre 2003 et 2005? Dans le Nord-Kivu, encore aujourd’hui? Ou face aux attaques terroristes qui dévastent le Sahel et l'inaction de l'ONU en Afrique devant les coups d’État constitutionnel des politiques sources de tensions?
On peut dire que l'ONU n'intervient jamais en Afrique comme en 1991 lors de la guerre du Golfe pour mettre fin aux conflits. Cependant, toujours absente, toujours silencieuse, toujours partisane, l’ONU n’apparaît que lors les intérêts américains sont menacés. Cette inaction n’a rien d’un hasard, car elle découle de la nature même de l’organisation. Créée en 1945 à San Francisco, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’ONU n’a jamais été conçue pour défendre la paix universelle, mais pour préserver l’ordre mondial dominé par les puissances occidentales, en premier lieu, les États-Unis.
Pour comprendre cela les Africains doivent remonter dans les années 1950, le président américain Dwight Eisenhower (1952-1960) avait tracé la voie pour ne plus intervenir directement en Afrique, mais agir à travers les Nations unies pour protéger les intérêts américains. Une stratégie confirmée des décennies plus tard par John Bolton, sous-secrétaire d’État à la sécurité internationale sous l’administration Bush (2000-2008). « Les Nations unies n’existent pas », déclarait-il sans détour à travers une réunion à Washington en 1994. « Il existe une communauté internationale, parfois dirigée par la seule vraie puissance mondiale: les États-Unis. Quand les États-Unis dirigent, l’ONU suit. Et nous ne dirigeons que lorsque cela sert nos intérêts nationaux. »
En Afrique, ce schéma se répète inlassablement. Les interventions onusiennes se multiplient, mais rarement pour sauver des vies. Elles servent avant tout à protéger des intérêts géostratégiques comme contrôler les ressources, endiguer l’influence de puissances concurrentes, maintenir des zones d’influence héritées de la colonisation. Et quand il s’agit d’un conflit européen, comme celui de l’ex-Yougoslavie, ou d’une guerre au Moyen-Orient, l’ONU s’efface et l’OTAN prend la relève, souvent au mépris du droit international.
L’histoire du continent le prouve. En 1960, lors de la crise congolaise, les troupes onusiennes ont empêché les partisans de Patrice Lumumba d’agir, ouvrant la voie à son arrestation, sa torture et son assassinat. L'objectif était d'éviter que le Congo ne bascule dans le camp soviétique et garantir aux États-Unis un accès privilégié à l’uranium et au coltan, ressources essentielles à l’industrie militaire et nucléaire et des avions à réactions.
Cependant, les armées occidentales ont du mal à s'imposer dans les champs de bataille africaine. Elles accumulent les échecs comme à Kolwezi en 1978 au Zaïre, la Somalie en 1993, le Mali plus récemment. Les puissances étrangères ne comprennent ni le terrain, ni les réalités africaines. Et pendant ce temps, les Africains continuent d’attendre une aide qui ne viendra pas.
En somme, il est temps de rompre avec cette illusion. L’Afrique doit se doter d’une force militaire commune comme ECOMOG dans la CEDEAO, d’une armée interafricaine indépendante, capable d’intervenir rapidement là où les Nations unies font des calculs géostratégiques. Une défense construite par et pour les Africains, au service du continent et non d’intérêts extérieurs. Tant que l’Afrique confiera sa sécurité à d’autres, elle restera vulnérable aux manipulations géopolitiques des grandes puissances. Le Soudan n’est pas une exception, c’est un avertissement.
Soit l’Afrique prend son destin en main, soit elle continuera d’être spectatrice de sa propre tragédie.
Maodo Ba Doba
Historien militaire contemporain,
Professeur en Études stratégiques de défense et politiques de sécurité.