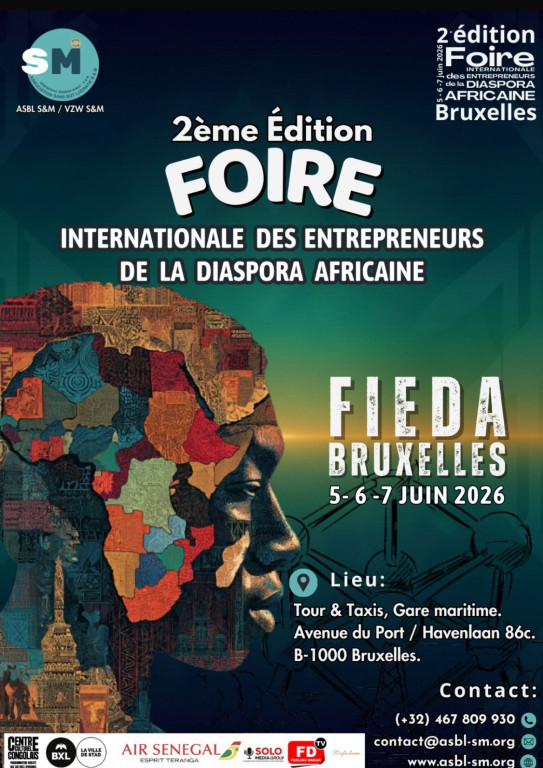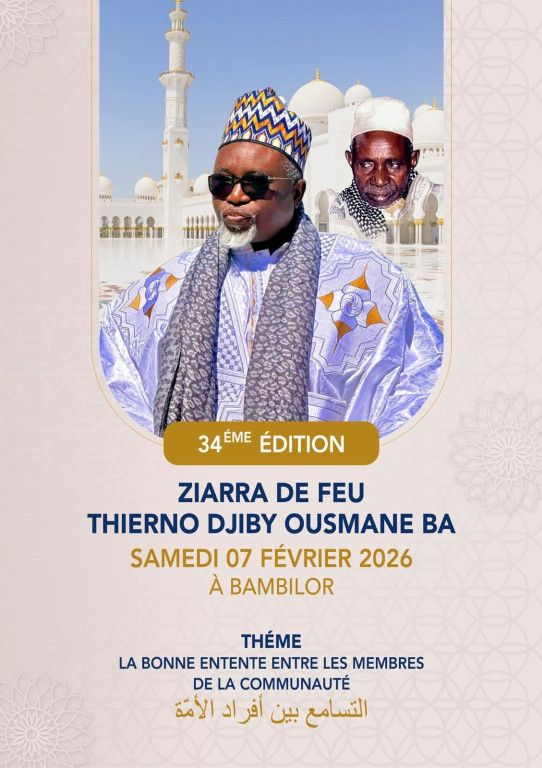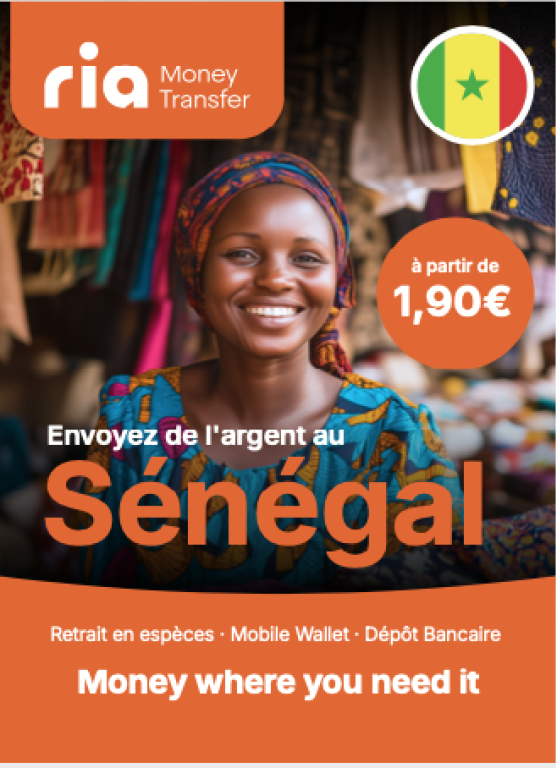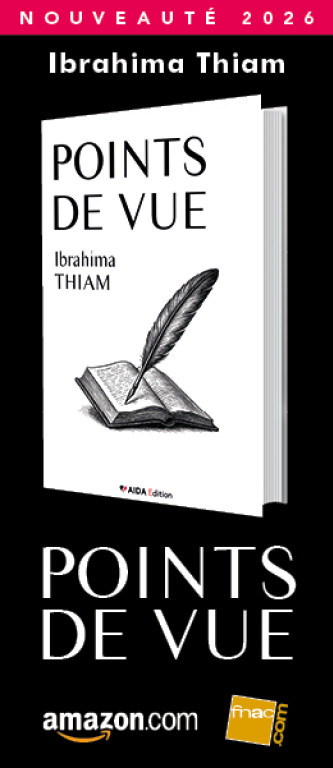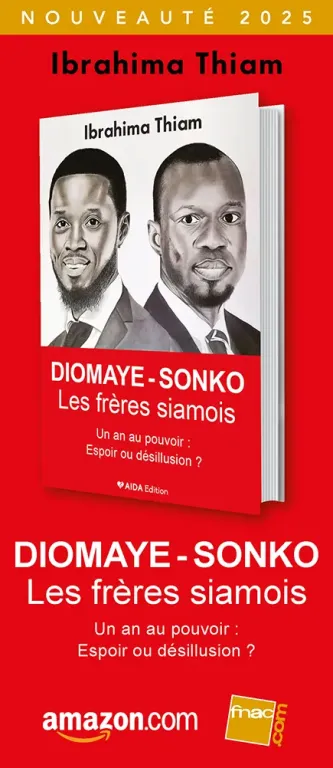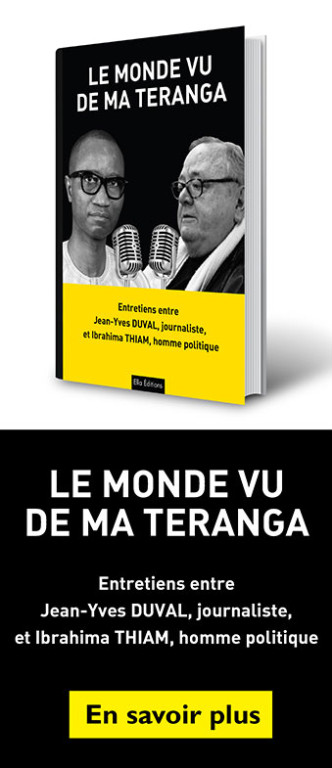ANALYSES ET DÉCRYPTAGE POLITIQUE: La stratégie Sonko, ou la fondation du pouvoir anticipatoire.
Le pouvoir, disait Machiavel, n’est jamais une simple affaire d’institutions : il est d’abord un art de la durée. Il faut à la fois savoir quand se retirer, quand se taire et quand inscrire son silence dans la structure même du commandement. C’est à cet art du retrait fécond qu’Ousmane Sonko semble avoir accédé au moment même où la victoire révolutionnaire du Pastef se traduisait par l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. Beaucoup, observant ce dispositif, ont voulu y voir un simple épisode de délégation politique, un transfert tactique destiné à contourner les contraintes judiciaires et administratives imposées à Sonko. Mais l’analyse attentive de ce que l’on pourrait nommer le « protocole du Cap Manuel » révèle bien davantage : une stratégie d’institutionnalisation du sens, une théorie implicite du pouvoir anticipatoire où la domination ne se joue pas dans l’exercice, mais dans la capacité à fonder l’horizon de légitimité du régime.
Le Cap Manuel n’a pas été seulement une prison ; il fut un lieu de condensation historique. Comme autrefois la forteresse de Pierre et Paul pour les bolcheviques, il a servi de matrice spirituelle et politique à une recomposition totale du champ sénégalais. C’est là, dans le silence et l’enfermement, que Sonko et Diomaye ont redéfini la relation entre le pouvoir et la loyauté, entre la fonction et la foi. La configuration qui en est sortie n’est pas sans rappeler, par analogie, le syndrome Medvedev-Poutine : ce moment russe où Vladimir Poutine, empêché constitutionnellement, délégua formellement le pouvoir présidentiel à Dmitri Medvedev, tout en conservant les leviers effectifs de la domination à travers son poste de Premier ministre. Pourtant, là où la Russie vit un artifice de continuité oligarchique, le Sénégal, sous Sonko, expérimente une continuité révolutionnaire d’un genre inédit. L’enjeu n’est pas de contourner une Constitution, mais d’inventer un pouvoir qui survit à la forme institutionnelle du trône.
Le syndrome Medvedev-Poutine repose sur une distinction claire entre pouvoir légal et pouvoir réel : l’un détenu par l’institution, l’autre conservé par la figure charismatique. Mais Sonko a poussé plus loin l’ingénierie symbolique : il a choisi de se situer en dehors même de la hiérarchie institutionnelle. Plutôt que de devenir président de l’Assemblée nationale, position qui l’aurait placé constitutionnellement au second rang de l’État et potentiellement en position d’intérim présidentiel en cas de vacance du pouvoir, il s’en est délibérément écarté. Ce refus, qui surprit nombre d’analystes, n’est pas une erreur stratégique, mais une manifestation parfaite de la ruse machiavélienne : la conscience que le pouvoir véritable se conquiert dans le temps long de l’influence, et non dans la brève ivresse de la fonction.
Car la présidence de l’Assemblée nationale aurait constitué une arme à double tranchant. Elle aurait offert à Sonko une voie légale vers la magistrature suprême en cas d’empêchement du Président, mais elle aurait aussi installé la suspicion permanente d’une rivalité latente. Le régime aurait vécu sous le spectre d’une dualité de commandement. Les bailleurs, les corps administratifs et les partenaires internationaux auraient testé la loyauté de chacun, provoquant une fragilité interne comparable à celle qu’ont connue nombre de régimes de transition dans les années 1980. En refusant ce scénario, Sonko a évité de substituer à l’unité révolutionnaire une cohabitation concurrentielle. Il a compris qu’un pouvoir bicéphale n’est jamais durable : il tue la confiance, et avec elle, la cohérence du récit collectif.
Machiavel aurait salué une telle clairvoyance. Dans Le Prince, il enseigne que la plus grande vertu d’un homme d’État est de savoir paraître sans toujours être, et d’agir sans toujours se montrer. L’art du Prince ne consiste pas seulement à conquérir le pouvoir, mais à le rendre durable en l’instituant dans la conscience collective. En cela, Sonko s’inscrit dans la catégorie des fondateurs – ces hommes qui, selon Machiavel, créent non pas un ordre politique pour leur génération, mais une doctrine capable d’éduquer le futur. Son refus de la présidence de l’Assemblée nationale n’est donc pas une fuite, mais une fondation : il s’agit de bâtir un pouvoir symbolique qui dépasse la contingence des mandats. Là où beaucoup auraient cherché la consécration immédiate, il choisit l’endurance du sens.
Ce choix a une portée épistémologique majeure : il transforme la révolution pastefienne en paradigme, et non en épisode. En se tenant à distance des institutions, Sonko se réserve le rôle du gardien de l’esprit, de l’interprète du pacte originel. Diomaye gouverne, mais Sonko conserve la capacité de nomination symbolique. C’est lui qui, par ses discours, ses silences et ses allusions, continue de définir la légitimité de chaque geste politique. Nous assistons là à une mutation profonde de la logique du pouvoir en Afrique francophone : l’émergence d’un métapouvoir, c’est-à-dire un pouvoir de second degré, qui n’exerce pas, mais oriente ; qui ne décide pas, mais détermine ce que signifie la décision. En cela, Sonko invente une nouvelle forme d’hégémonie : non plus la domination par l’État, mais la domination par le sens.
La lecture machiavélienne de ce processus met en lumière un paradoxe fascinant : Sonko, en renonçant à la fonction, augmente sa puissance. Il comprend que celui qui détient le monopole du récit détient plus que celui qui détient le monopole de la loi. Ce que Poutine a réalisé par la coercition administrative, Sonko l’accomplit par la légitimité morale. En demeurant hors du champ institutionnel, il préserve à la fois la pureté révolutionnaire de son image et la capacité d’arbitrer, au besoin, la ligne idéologique du régime. L’État officiel est dirigé par Diomaye, mais l’État symbolique – celui des fidélités, des imaginaires et des affects – demeure sous l’emprise de Sonko. Ce double système crée une stabilité paradoxale : l’un gouverne pour consolider, l’autre incarne pour pérenniser.
Si Sonko avait accepté la présidence de l’Assemblée, l’équilibre se serait rompu. La proximité formelle avec le pouvoir exécutif aurait suscité des spéculations permanentes sur une éventuelle succession. En cas de vacance du pouvoir, il aurait été contraint de devenir Président intérimaire, et cette transition aurait réactivé les passions partisanes, ressuscitant l’idée d’un “retour du chef” par voie institutionnelle. Ce n’est pas là le projet de Sonko. Sa stratégie ne vise pas à revenir, mais à demeurer. Il ne cherche pas la revanche, mais la rémanence. En s’excluant de la chaîne de commandement, il s’installe dans la mémoire politique, non dans la compétition hiérarchique. Il choisit d’être le législateur invisible plutôt que le successeur possible. Ce déplacement – de la fonction à la fondation – est le geste le plus radical que puisse accomplir un homme de pouvoir.
Dans cette logique, la posture de Sonko rejoint les grandes figures machiavéliennes du Prince instituant : ceux qui créent l’ordre au lieu de le servir. Comme Moïse ou Romulus dans l’imaginaire du Florentin, il s’efforce de donner au Sénégal un récit fondateur capable de structurer plusieurs générations. Son projet dépasse la conquête du pouvoir ; il vise la refondation de la souveraineté populaire. En créant un espace de double légitimité – l’une administrative, incarnée par Diomaye, l’autre doctrinale, incarnée par lui-même –, il neutralise les forces de régression et déplace le centre de gravité du pouvoir vers le peuple. Car c’est là le cœur du “pouvoir anticipatoire” : construire des institutions dont la signification dépasse ceux qui les occupent.
Dans la perspective épistémologique, le geste de Sonko s’inscrit dans une temporalité longue, presque heideggérienne, où l’Être du politique précède son exercice. En retirant son corps de l’appareil d’État, il conserve son nom dans le registre du mythe. Il devient un opérateur d’historicité : celui par qui la révolution se rappelle à elle-même. Son choix relève ainsi d’une économie de la présence différée : il n’agit plus directement, mais son absence même agit. La puissance n’est plus le fait de gouverner, mais de demeurer la référence qui rend tout gouvernement pensable. Cette stratégie est d’autant plus subtile qu’elle se fonde sur une maîtrise parfaite de la psychologie collective : le peuple sénégalais, échaudé par des décennies de désillusions, ne croit plus aux promesses institutionnelles, mais il continue de croire aux figures de sens. Sonko occupe désormais cette fonction : celle d’un intercesseur entre la foi politique et l’État.
Il faut enfin souligner que cette stratégie n’est pas sans risques. Tout pouvoir symbolique est exposé à l’érosion du temps et à la récupération des élites. Mais là encore, Machiavel éclaire la manœuvre : la durée d’un prince dépend de sa capacité à renouveler la crainte et l’espérance. En se tenant à distance, Sonko garde intacte la possibilité de revenir dans l’imaginaire collectif à tout moment, non pour reprendre le pouvoir, mais pour rappeler la norme. Il se place dans une position quasi métaphysique : celle du fondateur dont la parole fonde l’ordre. Si demain Diomaye devait s’éloigner de la ligne révolutionnaire, la simple référence au pacte du Cap Manuel suffirait à restaurer l’autorité morale de Sonko. Cette autorité n’a pas besoin d’un décret : elle repose sur la mémoire d’un sacrifice, sur la densité d’une légitimité construite dans la douleur et le courage.
C’est dans ce contexte qu’il faut lire le meeting politique du 8 novembre, dont la portée dépasse largement la démonstration de force partisane. Ce rassemblement, annoncé comme une “clarification populaire”, n’est pas un retour de Sonko sur la scène du pouvoir, mais une réaffirmation de son magistère symbolique. Il marque le moment où la révolution teste sa cohérence face aux forces centrifuges du champ politique sénégalais. Le parti Awalé, en se repositionnant et en cherchant à se présenter comme alternative dans la recomposition du pouvoir, contribue à rebrasser les cartes. Mais ces mouvements ne font que confirmer l’intuition de Sonko : le système postlibéral sénégalais est entré dans une phase d’ajustement, où l’État doit être réinventé à partir de la souveraineté populaire et non de l’équilibre des partis. Le meeting du 8 novembre devient alors un acte de régulation symbolique : Sonko y rappellera non pas son ambition, mais la finalité du projet révolutionnaire. Dans un espace politique où tout se redéfinit – de la géopolitique des alliances à la structure des loyautés –, il réaffirme que la seule constante doit être l’idée de justice et de dignité collective.
Ainsi comprise, la stratégie Sonko n’est pas une tactique électorale ; c’est une refondation ontologique du politique au Sénégal. Elle substitue au jeu de l’alternance un jeu de la permanence du sens. Là où le syndrome Medvedev-Poutine traduisait la peur de perdre le pouvoir, le protocole du Cap Manuel traduit la volonté de ne pas perdre l’âme. C’est la différence entre un empire qui se reproduit et une révolution qui se perpétue. En cela, Sonko invente une forme de gouvernance anticipatoire : il ne gouverne pas le présent, il gouverne la mémoire du futur. Et c’est peut-être là la plus grande leçon machiavélienne de notre temps : celui qui sait différer son couronnement détient déjà la couronne du temps long. Sonko ne joue pas la présidence. Il institue le sens. Il ne veut pas le pouvoir ; il veut le monde qui le rend possible.
Moussa SARR, Ph.D.
Président Directeur Général
Lachine Lab L'Auberge Numérique
Fondateur et chercheur principal
Centre de Liaison & Transfert Ndukur