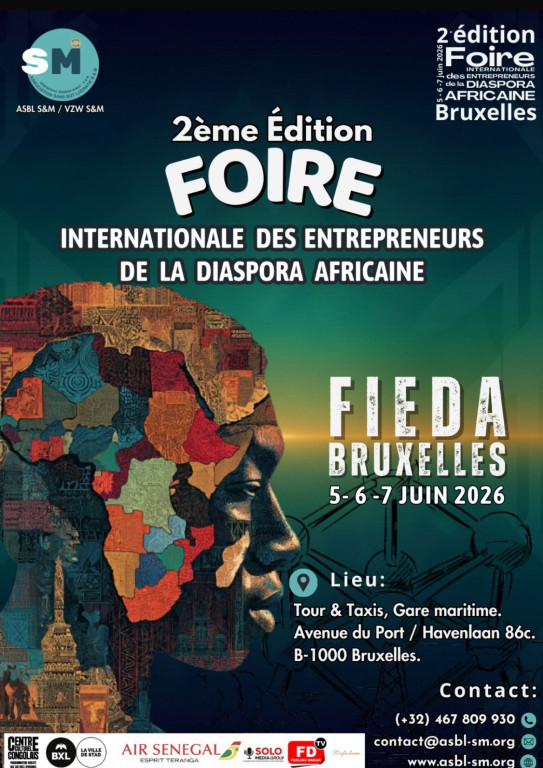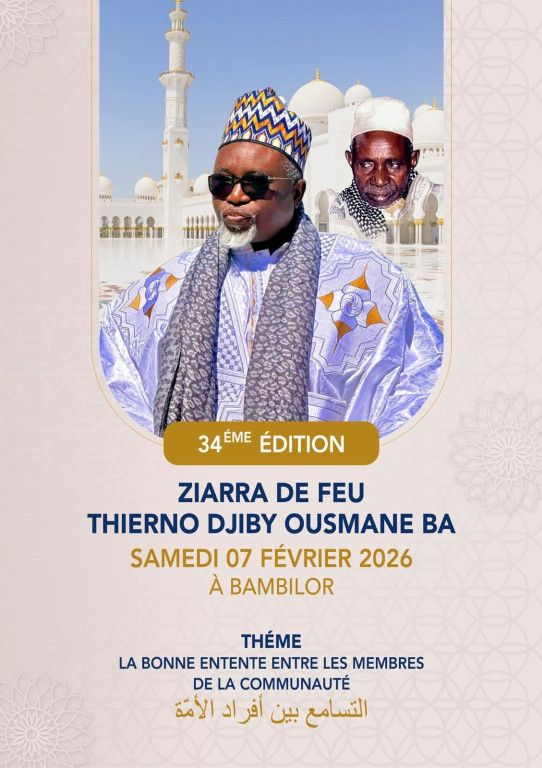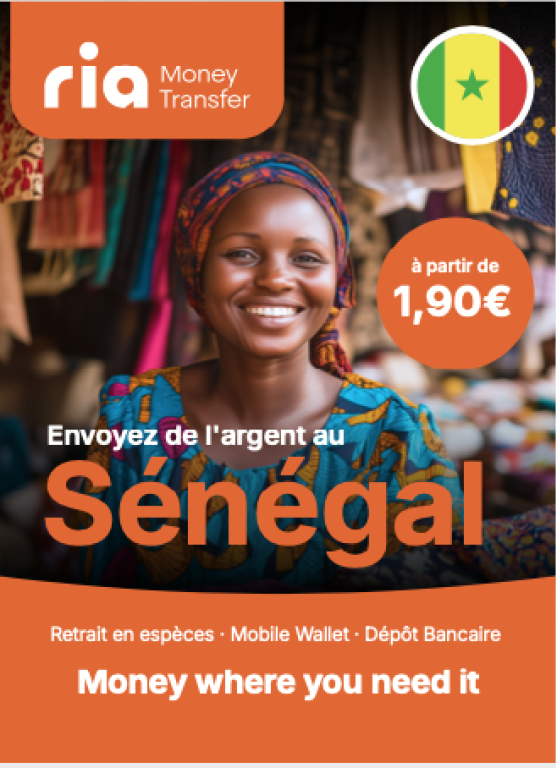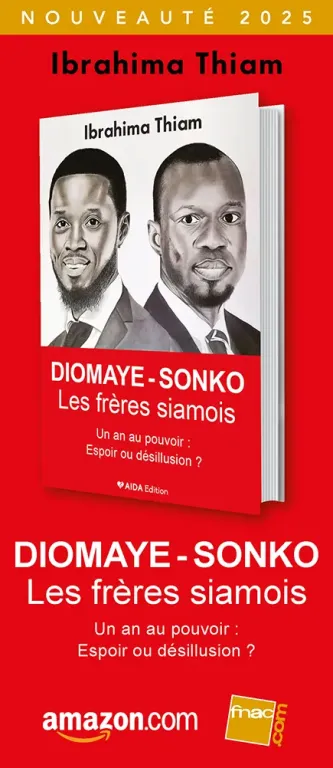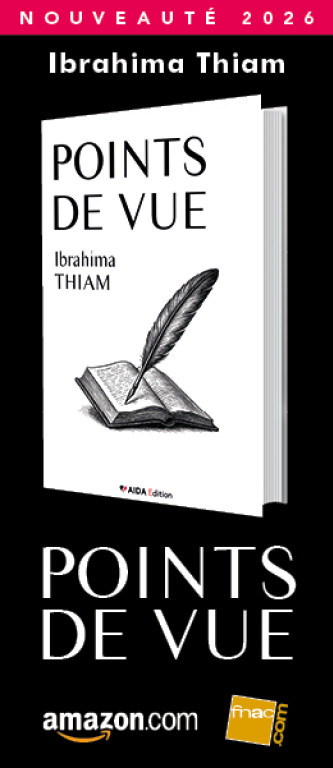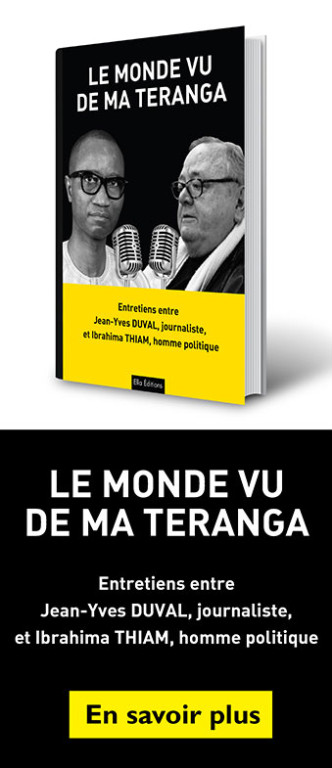Analyse pour mieux comprendre la guerre russo-ukrainienne: ses causes historiques, géopolitiques et ses conséquences sur les dynamiques sécuritaires présentes et futures africaines.
La guerre russo-ukrainienne, qui s’enlise dans les plaines de l’Europe centrale, dépasse largement le cadre régional. Elle redéfinit les équilibres géopolitiques en Europe et dans le monde avec des répercussions notables jusqu’en Afrique. Une analyse structurée permet de comprendre les origines historiques et géopolitiques ainsi que les implications concrètes sur le continent africain.
Les causes historiques et géopolitiques du conflit trouvent ses racines dans l’héritage de la Guerre froide et la désintégration de l’Union soviétique. D'ailleurs, les liens historiques entre ces deux peuples remontent au IXe siècle à travers le Rus' de Kiev, un État slave orthodoxe en Ukraine, considéré comme le berceau de la Russie. En outre, la chute du mur de Berlin à la fin des années 1980 et l’effondrement de l’URSS en 1991 marquent un tournant majeur. En effet, l’Ukraine devient indépendante, mais reste perçue par la Russie comme une composante historique de sa sphère d’influence. La Crimée, notamment la ville stratégique de Sébastopol, cristallise cette tension. Cédée à l’Ukraine en 1954 par le Président soviétique Nikita Khrouchtchev (1953-1964), d’origine ukrainienne, cette région est restée un point de friction, en particulier à cause de la base navale russe qu’elle abrite.
Par ailleurs, l’élargissement progressif de l’OTAN et de l’Union européenne aux anciens États du bloc soviétique comme la Pologne et les pays baltes depuis les années 2000 est vécu à Moscou comme un encerclement stratégique. L'Ukraine, en tant que grande puissance frontalière, incarne cette menace potentielle. Les mouvements pro-européens en Ukraine, comme la Révolution orange de 2004 et surtout l’Euromaïdan en 2014, accentuent son basculement vers l’Ouest et provoquent la colère de Moscou. L’annexion de la Crimée en 2014, suivie du conflit dans le Donbass, marque une escalade. La Russie organise un référendum controversé en Crimée, qui débouche sur son rattachement à la Fédération de Russie. Simultanément, elle soutient militairement les séparatistes prorusses dans l’Est de l’Ukraine. Moscou justifie son action par la volonté de protéger les populations russophones, victimes, selon elle, de discriminations et d’exactions.
En février 2022, Vladimir Poutine lance une offensive militaire d’ampleur contre l’Ukraine, officiellement pour "dénazifier" et "démilitariser" le pays. C'est "l'Opération spéciale russe" sous le commandement direct du Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En réalité, les motivations sont davantage géopolitiques, identitaires et stratégiques. Pour le président russe, l’Ukraine et la Russie forment historiquement une même nation. Cette vision nie l’identité nationale ukrainienne et cherche à restaurer une certaine grandeur perdue de la Russie impériale ou soviétique, tout en s'opposant à l'influence occidentale en Europe de l'Est. En plus, certains des noyaux durs du gouvernement russe, anciens collègues du KGB parfois comme Vlademir Poutine, Sergueï Lavrov (Ministre des affaires étrangères), Alexandre Bortnikov (Directeur du FSB ex-KGB), Piotr Tolstoï (Vice Président de la Douma)ou Sergueï Choïgou (Ministre de la Défense) incarnent la ligne dure de la politique étrangère russe envers l'Occident. C'est un clic utranationaliste russe qui ne souhaite que l'effondrement de l'Occident.
La guerre d’usure se dirige vers un conflit gelé. En effet, malgré des avancées initiales, l’armée russe échoue à prendre Kiev et se replie vers le Donbass et Louhansk. Grâce à un soutien militaire massif de l’Occident (chars, F-16, systèmes antiaériens, drones, renseignements satellites...), l’Ukraine parvient à reprendre des territoires, notamment à Kharkiv et Kherson. En 2023, le conflit se transforme en guerre d’usure, marquée par des lignes de front figées, des bombardements incessants et la construction de fortifications. En 2024-2025, les combats restent intenses, particulièrement dans le Donbass. L’Ukraine reçoit des équipements militaires plus sophistiqués, tandis que la Russie adapte sa stratégie en intensifiant les frappes de missiles hypersoniques sur les infrastructures civiles et énergétiques. Parallèlement, elle renforce ses alliances militaires. La Biélorussie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord deviennent des partenaires stratégiques. Pyongyang aurait envoyé entre 14 000 et 45 000 soldats en soutien à l’effort de guerre russe, selon différentes sources comme Moscou, Kiev, et Washington. De plus, l’Iran fournit à la Russie des drones kamikazes Shahed-131 et 136, massivement utilisés contre les installations ukrainiennes. On note également la participation aux combats de mercenaires africains dans les deux camps avec souvent des motivations pécuniaires.
Au-delà de la participation aux affrontements, le conflit a des répercussions contrastées sur la géopolitique africaine. En d'autres termes, le conflit russo-ukrainien agit comme un catalyseur de réalignements diplomatiques. Beaucoup de pays africains adoptent une position de neutralité stratégique comme en témoignent les nombreux votes d’abstention à l’ONU. Ils refusent de s’aligner explicitement sur l’Occident ou sur la Russie. En plus, la guerre accélère le repositionnement de la Russie en Afrique qui en quête de partenaires pour contourner son isolement diplomatique en renforçant ses liens avec plusieurs régimes. Le groupe paramilitaire Wagner, rebaptisé "Afrika Corps", devient un acteur sécuritaire incontournable en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ce retour russe est favorisé par un climat de défiance croissante envers les puissances occidentales dans le Sahel où les opérations antiterroristes occidentales sont jugées inefficaces, voire contre-productives depuis le début des années 2010. En réaction, certains observateurs soupçonnent un soutien indirect de l’Ukraine à des groupes armés opposés à la présence russe en Afrique bien que ces accusations restent controversées et peu étayées.
Le conflit ravive également une forme de "guerre froide" sur le continent africain, où les grandes puissances se disputent l’influence à travers la coopération militaire ou la propagande. La perception du conflit ukrainien par certains dirigeants africains souligne un double standard occidental, notamment dans la gestion des crises humanitaires et des réfugiés. La médiatisation intense de la guerre en Ukraine contraste avec l’indifférence souvent affichée face aux tragédies africaines..
En somme, la guerre russo-ukrainienne dépasse largement le cadre d’un affrontement bilatéral. Elle s’inscrit dans une reconfiguration globale de l’ordre international post-Guerre froide. Pour l’Afrique, ce conflit révèle les fragilités politiques mais ouvre aussi des opportunités de repenser les alliances, de renforcer l’autonomie stratégique et de s’imposer comme un acteur diplomatique à part entière dans un monde multipolaire.
Maodo Ba Doba
Historien militaire contemporain,
Professeur en Études stratégiques de défense et politiques de sécurité.