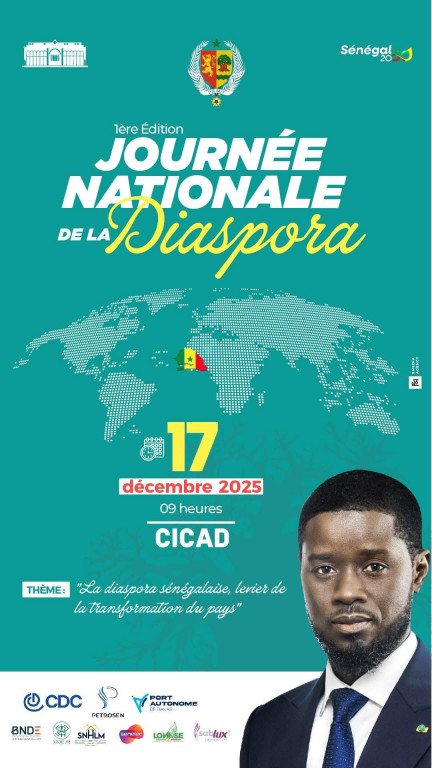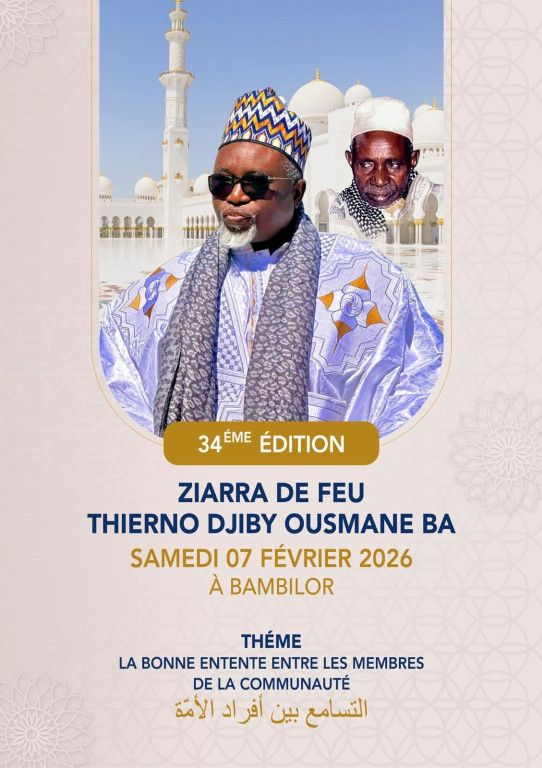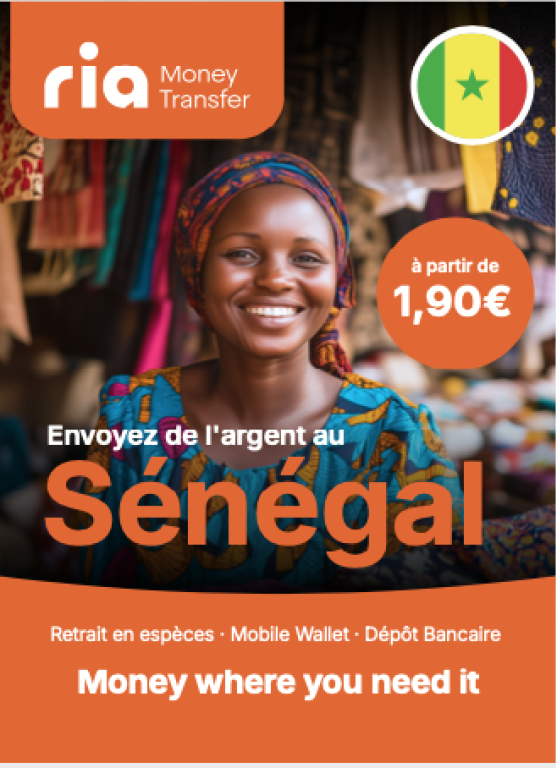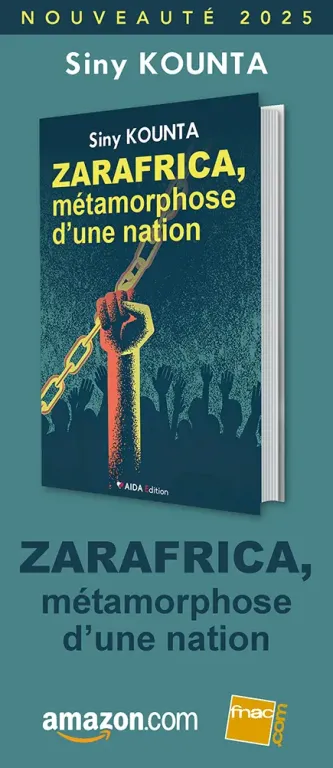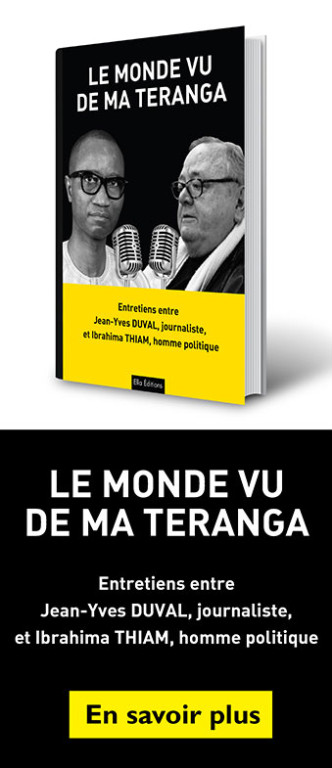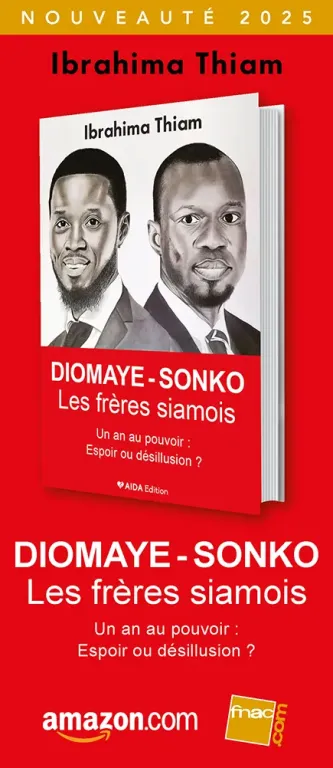Entretien Exclusif Avec Monsieur ALHassane Niang Jiitël Wareef
Quelles stratégies concrètes le parti Jiitël Wareef – Le Devoir e Mouvement met-il en œuvre pour élargir sa base militante et renforcer sa présence sur l’échiquier politique national ?
Permettez-moi d'abord de rendre hommage au Khalife de Darou Khoudos, Serigne Ahmadou Moctar MBACKE, dont le rappel à Dieu survenu vendredi dernier a laissé un vide profond dans le cœur de ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de l'aimer. Il était bien plus qu'une figure de notabilité ; il était une source d'inspiration et un réservoir de vertus cardinales. Sa générosité, affranchie de tout calcul, se manifestait avec une noblesse innée, tandis que son intégrité exemplaire offrait une boussole morale à ceux qui avaient la chance de croiser sa route. Son attention envers autrui était constante et réconfortante, accompagnée d'une humilité et d'une sérénité révélant une force de caractère et une sagesse rares. Héritier d'un lignage spirituel illustre, il fut un érudit éminemment versé dans les sciences religieuses, abreuvé à la source intarissable de l'enseignement de son auguste aïeul, Cheikh Ahmadou Bamba. Son intellect, toutefois, transcendait les cloisonnements. Intellectuel accompli, il mit son savoir étendu au service de la nation sénégalaise qu'il servit avec abnégation et passion dans ses fonctions diplomatiques, personnifiant ainsi la synthèse rare entre élévation spirituelle et acuité diplomatique. Sa disparition subite est une perte irrémédiable pour la confrérie mouride, pour le Sénégal et pour l'ensemble de la Oumma islamique. Sur le plan personnel, je perds une figure paternelle et un mentor d'une rare sollicitude. Je lui vouais une affection et un respect indéfectibles. Son attention à mon égard demeurait inébranlable. Chaque échange était pour lui une occasion de me prodiguer des conseils empreints de sagesse, dont chaque parole était à la fois une semence pour l'avenir et un précieux viatique. Nous implorons Allah SWT, le Miséricordieux, de l'accueillir en Sa miséricorde infinie et de lui accorder une place de choix aux côtés des justes.
Face aux mutations profondes que l'échiquier politique sénégalais a connues durant les cinq dernières années, Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement a fait l’option de s’appuyer sur le déploiement d’une stratégie d'implantation méthodique, conjuguant l'ancrage territorial et la modernité communicationnelle. Notre approche repose sur un travail de terrain, où des visites ciblées et des dialogues directs nourrissent une relation de confiance avec nos concitoyens, nous permettant de capter les aspirations populaires sans intermédiation. Cette proximité organique est relayée par une présence médiatique au travers d’interventions dans les débats télévisés, les tribunes dans la presse écrite et l’utilisation élégante des réseaux sociaux. Cette formule permet en outre d’assurer la diffusion d'une rhétorique à la fois ambitieuse et pragmatique, notamment sur des questions structurantes et essentielles à la prise en charge des différents enjeux sociétaux, socio-économiques, démocratiques et institutionnels. Parallèlement, une communication innovante et bien réfléchie est déployée de façon séquentielle pour cibler avec précision la jeunesse et la diaspora. Cet édifice est consolidé par un maillage territorial robuste, où des réunions thématiques et des actions sociales ou de solidarité concrète permettent d’incarner notre engagement sur le terrain, tandis que la formation exigeante de nos militants, véritables ambassadeurs de la doctrine de notre parti, garantit l'homogénéité et la vigueur de notre message. Ainsi se tisse progressivement une alternative crédible, aussi à l'aise dans l'échange avec le citoyen que dans les arènes médiatiques nationales.
2. Quels sont les secteurs ou régions prioritaires dans lesquels vous concentrez vos efforts de massification ?
Notre stratégie de massification repose sur une visée exhaustive couvrant l'ensemble du territoire national. Dès la création de notre parti, nous-nous sommes employés à structurer notre présence dans les quarante-six départements du pays, considérant chaque région comme une priorité dans notre dispositif d'implantation. Cette approche méthodique s'est accompagnée d'une attention particulière pour la région de Thiès, qui constitue pour nous une base affective significative et historique. Cette assise territoriale privilégiée fait l'objet d'un ancrage renforcé, sans pour autant altérer l'impératif d'une représentation équilibrée du parti sur l'ensemble du territoire. Par ce moyen, nous conjuguons ainsi deux échelles complémentaires permettant à la fois une couverture nationale systématique, garantissant notre présence dans toutes les zones géographiques et un ancrage ciblé dans certaines localités stratégiques, où notre implantation est susceptible de revêtir une portée tant symbolique qu'opérationnelle. Cette dualité constitue pour nous un levier à partir duquel nous fondons l'universalité de notre projet politique et la profondeur de son enracinement local, conformément à notre référentiel des valeurs et notre vision d'une démocratie participative et inclusive.
3. Le parti mise-t-il davantage sur des alliances politiques, des actions de proximité ou sur un discours programmatique pour séduire de nouveaux adhérents ?
A la faveur des expériences récentes plus ou moins réussies, Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement envisage de miser sur une stratégie triadique pour conquérir de nouveaux adhérents, articulant de manière complémentaire les alliances politiques, les actions de proximité et un discours programmatique substantiel. Notre approche privilégie la constitution d'un regroupement de formations politiques en vue des élections locales, visant à fédérer des acteurs divers autour d'un projet commun solidement arrimé à une idéologie cohérente et exigeante. Cette volonté coalitionnelle que nous appelons de nos vœux, permet d'enrichir notre singularité par le dialogue et la convergence programmatique. Parallèlement, nous investissons un travail de terrain méticuleux dans les régions du pays à la faveur de rencontres citoyennes, d’implantations locales, d’écoute active des préoccupations concrètes, qui constitue le socle de notre légitimité. Ces actions de proximité permettent d’ancrer notre discours dans le réel tout en garantissant son adéquation aux besoins exprimés. Cet édifice s'appuie enfin sur un discours programmatique sophistiqué adossé à notre projet sociétal élaboré dès la création du parti. Notre référentiel unique de valeurs cardinales et notre projet sociétal global ainsi que notre programme politique font l'objet d'une réactualisation permanente à l'aune des enjeux contemporains, notamment économiques et sociaux. Cette capacité d'adaptation intellectuelle, sans reniement de nos fondamentaux, assure la pertinence et la modernité de nos propositions. Je terminerai par le fait que la force de la coalition que nous comptons mettre en place résidera dans la synergie de ces trois leviers : la puissance fédératrice des alliances, la légitimité conférée par notre ancrage terrain et la profondeur visionnaire portée par un programme robuste et évolutif. C'est par cette articulation dialectique que nous ambitionnons de convaincre tant les acteurs politiques que les citoyens.
4. Comment le Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement entend-il se démarquer des autres formations politiques qui, elles aussi, cherchent à s’implanter davantage dans la population ?
Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement se distingue par une approche politique singulière, fondée sur un substrat axiologique rigoureux qui informe tant son engagement militant que ses propositions programmatiques. Cette assise conceptuelle, articulée autour d'une vingtaine de principes directeurs dont la responsabilité confère à son action une cohérence et une profondeur souvent absentes du paysage politique conventionnel. Le parti privilégie une immersion documentaire et terrain méticuleuse, analysant les politiques publiques depuis l'indépendance pour fonder ses propositions sur une compréhension historiquement informée des enjeux nationaux. Son différenciateur réside dans un pragmatisme éclairé, refusant tout à la fois le populisme facile et l'idéologie rigide. Notre engagement se manifeste par une défense intransigeante des libertés fondamentales et du débat démocratique, dénonçant avec constance toute entrave à la libre expression. Parallèlement, notre ancrage local est substantif au travers d’initiatives ciblées visant une autonomisation concrète des communautés. En somme, Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement incarne une tentative de refondation de la pratique politique sénégalaise, alliant une éthique exigeante, une méthodologie rigoureuse et une vision programmatique innovante, afin d'offrir une alternative crédible aux modèles établis.
5. Quelle lecture faites-vous de la situation économique actuelle du Sénégal ?
La situation économique actuelle du Sénégal présente un paradoxe des plus saisissants. D'un côté, l'économie affiche une croissance, officiellement projetée entre 8% et 9,3% pour 2025, portée par le secteur tertiaire et l'exploitation naissante des champs pétroliers et gaziers. De l'autre, elle est minée par une crise de gouvernance et de confiance aux conséquences profondes. La révélation d'une dette cachée colossale, avoisinant les 7 milliards de dollars, a contraint à une révision drastique des comptes nationaux, portant le ratio d'endettement public à près de 120% du PIB. Cet état de fait a provoqué la sanction immédiate des marchés financiers. Celle-ci s’est manifestée par la dégradation de la note souveraine à trois reprises, la fuite des investisseurs et le renchérissement prohibitif du crédit. Le Fonds Monétaire International a, de surcroît, gelé son programme d'assistance, privant l'État d'un financement crucial. Cette stratégie d'endettement opaque, couplée à une mobilisation difficile des recettes internes, a engendré une défiance généralisée et une contraction de l'investissement public, asphyxiant le secteur privé national. Enfin, l'absence de lisibilité et de cohérence dans la trajectoire économique dessinée par les nouvelles autorités, oscillant entre une Vision 2050 et un Plan de redressement aux financements incertains, achève de brouiller les perspectives. Le Sénégal se trouve ainsi à un carrefour critique, où l'abondance promise par le nouveau régime est sévèrement compromise par des vulnérabilités macroéconomiques et institutionnelles accrues.
6. Quelles propositions le Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement avance pour stimuler la croissance économique et réduire la précarité des ménages ?
Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement propose une refondation économique structurelle articulée autour d'une pensée stratégique, d’un modèle endogène de développement et d'une revalorisation du Revenu National Brut (RNB) comme boussole des politiques publiques. Cette approche triptyque s’inscrira dans un régime de croissance au circuit économique fermé garantissant une distribution équitable des richesses et une réduction plus tangible de la précarité des ménages. Notre parti promeut un modèle inspiré des théories de la croissance endogène (Romer, Lucas), où la croissance est générée par des facteurs internes comme l’investissement dans les secteurs névralgiques tels que l’éducation, la santé, les infrastructures publiques, l’innovation etc. Ce choix passera par la mise sur pied d’un plan national de formation aligné sur les besoins des secteurs prioritaires (technologie, agriculture, énergie) mais aussi par des incitations fiscales permettant d’investir dans la recherche et développement et la formation continue. Avec une telle approche, l'État se voit réinvesti du rôle central d'agent à fois économique et du développement, ce qui lui permettra de moderniser l’Administration, d’investir stratégiquement et de réguler les secteurs clés. Il s’agira de mettre en place une stratégie qui s'articule autour d'un circuit économique fermé favorisant les boucles locales de production-consommation, soutenu par un Fonds Souverain plus ambitieux et plus significatif et des mesures de contrôle des capitaux. Cette approche holistique permettra de garantir une distribution équitable des richesses, une réduction substantielle de la précarité et le renforcement de la souveraineté économique nationale. Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement défend une approche holistique et innovante de la croissance économique, où l’endogénéité du développement, la planification stratégique et la primauté du RNB sur le PIB sont érigées en principes directeurs. En visant un circuit économique fermé, le parti entend garantir que les fruits de la croissance profitent pleinement aux Sénégalais, réduisant ainsi la précarité des ménages et consolidant la souveraineté nationale. Cette vision nécessite une transformation profonde des institutions et des politiques publiques, mais elle offre une alternative crédible aux modèles extravertis qui ont montré leurs limites au Sénégal et ailleurs en Afrique.
7. Face aux défis liés au chômage des jeunes, à la cherté de la vie et à l’endettement du pays, quelles mesures urgentes votre parti recommande-t-il ?
La question de l’emploi ne saurait être dissociée d’une politique économique éclairée, globale et rigoureuse. Celle-ci implique que l’État accepte d’endosser pleinement son rôle d'Agent économique de premier plan. Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement recommande un schéma de relance économique par la dépense en capitaux en investissant massivement et prioritairement dans les infrastructures critiques. Cette présence accrue de l'État en tant qu'investisseur majeur permettra de servir de catalyseur pour irriguer l'économie et créer les conditions d'une croissance plus inclusive et durable. Pour maximiser l'impact de ces investissements, nous proposons que l’État agisse dans le cadre d'un circuit économique vertueux et plus fermé. En orientant stratégiquement la commande publique vers les entreprises nationales et les filières locales, chaque dépense en capital permettra de générer une valeur ajoutée qui circule et se multiplie. Cette approche, visant délibérément l'effet multiplicateur, permettra de soutenir directement l'activité des PME/PMI et TPE, de préserver et de créer des emplois sur l’étendue du territoire, et in fine, d'alimenter un régime de croissance plus performant et auto-entretenu. Le caractère informel prononcé du marché de l’emploi qui constitue une faille systémique et qui appauvrit à la fois les travailleurs et les finances publiques doit faire l’objet d’un traitement prioritaire. Pour y remédier, une régulation économique intelligente et ciblée s'impose. Elle passera par un allègement des dérèglements multiples qui étouffent la survie des entreprises et dissuadent l'embauche. L'objectif est d'inciter fortement à la formalisation des emplois, élargissant ainsi l'assiette des cotisations sociales et protégeant les droits des salariés. Notre modèle de croissance actuel est notoirement peu créateur d'emplois. Il est impératif de revoir fondamentalement cette stratégie pour viser une élasticité de l'emploi bien supérieure. L'ambition doit être de parvenir à créer entre quatre-vingt mille et cent mille emplois par point de croissance. Cet objectif nécessite d'orienter les investissements publics et les incitations fiscales vers les secteurs à forte intensité de capital humain (i.e. transition écologique, économie circulaire, silver économie, tourisme de qualité) et de mettre l'accent sur la formation professionnelle aux métiers d'avenir. Enfin, le secteur privé, qui n'intervient aujourd'hui que pour une quantité négligeable dans le financement des investissements publics structurants, doit être pleinement associé et responsabilisé. Au-delà des simples incitations, des partenariats public-privé (PPP) repensés, transparents et équilibrés, doivent être encouragés pour co-financer de grands projets. Cette présence plus active du privé est cruciale pour démultiplier les ressources disponibles, partager les risques et soutenir massivement la création d'emplois pérennes. La réponse urgente que nous proposons est dès lors un interventionnisme étatique modernisé et intelligent : un Sénégal qui investit stratégiquement, qui utilise sa commande comme un levier de souveraineté économique, qui réforme le marché du travail pour le formaliser, qui cible une croissance riche en emplois et qui sait mobiliser le capital privé dans un effort national concerté. Cette approche holistique est la seule à même de relever simultanément les défis de l'emploi, du pouvoir d'achat et de la soutenabilité financière de la nation.
8. Comment le Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement envisage-t-il de mieux valoriser les ressources naturelles du pays pour en faire un véritable levier de développement ?
Le Sénégal est doté d'un patrimoine naturel diversifié, comprenant d’importantes ressources minérales (i.e. phosphate, fer, or, zircon, marbre etc.) ainsi que des ressources énergétiques non négligeables (i.e. thorium, gaz, pétrole). Le pays bénéficie également de ressources halieutiques considérables, avec l'une des plus grandes réserves de poisson au monde ; et de forêts riches en bois précieux. Malgré de telles dotations, ces ressources naturelles ne sont pas suffisamment exploitées pour répondre aux besoins, jouer un rôle essentiel dans l'économie sénégalaise et contribuer à une croissance permettant une création massive d’emplois. Face à ces défis économiques structurels, Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement propose de travailler sur une stratégie industrielle ambitieuse permettant de franchir le cap du deuxième et troisième niveau de transformation et inscrire notre politique industrielle dans le cadre d’un schéma à la fois régional et global. Il sera question de réfléchir à une stratégie industrielle fondée sur une transformation par segment et d’en faire de véritables leviers de développement durable. Cette approche multidimensionnelle s'articulera autour de trois axes fondamentaux destinés à garantir la souveraineté économique nationale. Notre parti préconise de soumettre de façon systématique les matières premières à un deuxième voire un troisième niveau de transformation locale pour non seulement créer de la valeur ajoutée sur le territoire national mais aussi pour spécialiser le pays sur certains segments du schéma de la chaine de valeurs régionales et globales.
Le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim avec la Mauritanie pourrait illustrer cette approche si elle est mise en œuvre dans le cadre d’une véritable vision sectorielle, où le développement d'usines spécialisées non pas seulement sur le développement de produits finis, mais aussi sur la spécialisation de segments de la chaine de valeurs régionales et globales permettrait de générer des centaines de milliers d'emplois qualifiés. Cette stratégie inclurait en outre un volet important d'industrialisation par le bas, favorisant aussi bien la substitution aux importations par la production nationale de biens essentiels que l’exportation de produits à forte valeur ajoutée. La stratégie de segmentation ciblée de certaines filières selon les avantages comparatifs régionaux constituera un maillon essentiel à la politique industrielle que le Sénégal devra élaborer dans le cadre de la valorisation des ressources naturelles du pays. Le développement de véritables zones économiques spéciales et intégrées adossé à une stratégie de soutien accru aux PME/TPE/PMI locales constitue le cœur de cette approche. Elle impliquerait que l’ADEPME, le FONSIS et le FONGIP soient réformés en profondeur afin d’aligner leur mandat et leurs moyens financiers sur les enjeux de cette approche. Les secteurs prioritaires comme l'agroalimentaire, l'énergie, les télécommunications et les mines devront bénéficier d'investissements massifs notamment en recherches et développement et en innovation. Une mobilisation nationale réfléchie autour d’une telle politique et d’une vision transformatrice placerait, de façon irrémédiable, les ressources naturelles au service du développement humain et économique durable de l'ensemble des Sénégalais. La réussite de cette ambition nécessitera une gouvernance rigoureuse, des investissements stratégiques et un partenariat étroit entre tous les acteurs économiques.
9. Les inondations affectent chaque année une grande partie du territoire national. Quelle analyse en faites-vous ?
Cette problématique est des plus complexes et mérite d’être traitée en profondeur car chaque année, notre pays fait face à des inondations dévastatrices qui paralysent des quartiers entiers, détruisent des infrastructures et plongent des milliers de familles dans le désarroi. Ce phénomène, loin d’être une simple fatalité climatique, révèle des failles profondes en matière de planification territoriale, de gestion urbaine et d’anticipation des risques. L’analyse met en lumière une urbanisation souvent anarchique, caractérisée par une imperméabilisation massive des sols, une obstruction des axes d’écoulement naturel des eaux et un développement frénétique de zones habitables dans des bassins-versants ou des plaines naturellement inondables. Les villes fluviales du bassin du fleuve Sénégal (Richard Toll, Podor, Matam) sont confrontées à un risque structurel lié aux crues du fleuve et aux débordements de la nappe phréatique qui remonte. Les Villes de la Moyenne Casamance (Kolda, Sédhiou, Bignona) font quant à elles face au double risque de fortes pluies locales et remontée généralisée de la nappe phréatique. Les sols étant gorgés d'eau, l'excédent pluvial ne peut s'infiltrer et stagne en surface, inondant les habitations souvent construites sans fondations étanches. Le cas emblématique de Dakar qui concentre tous les dysfonctionnements avec une amplitude critique est alarmant. Entre pression foncière et spéculation qui constituent une source d'enrichissement rapide pour un trio infernal constitué par les promoteurs immobiliers, la classe politique et les municipalités. Cette situation conduit à une urbanisation frénétique et prédatrice. La destruction des Zones d'Expansion de Crue (ZEC) qui sont des écosystèmes fragiles et des régulateurs (zone des Niayes - dépressions inter dunaires, zone de captage, Wakhinane-Nimzatt) et qui sont classés "zones rouges" inconstructibles dans les SDAU sont agressées en permanence. Elles sont massivement loties et bétonnées alors que la nappe affleure à moins de 2 m de profondeur dans ces zones qui sont naturellement vouées à retenir l'eau. Y construire est donc une invitation aux inondations. L'effet pervers de la Décentralisation (Acte III) qui a transféré la compétence foncière aux communes devait rapprocher la décision du citoyen. Il a été détourné en une machine à générer des revenus pour les municipalités via la vente de parcelles, y compris dans des zones non-constructibles. Le maire, pourtant garant de l'intérêt général, devient souvent un acteur clé de la spéculation. Ces choix, couplés à un réseau d’assainissement vétuste, sous-dimensionné et mal entretenu, transforment les quelques précipitations en catastrophes humanitaires pour nombre de nos concitoyens. Par ailleurs, les effets du changement climatique, avec une intensification des événements pluviométriques extrêmes, aggravent une situation déjà critique. Face à ce défi, la réponse ne peut se limiter à des mesures palliatives et réactives, comme le déploiement de pompes ou la distribution d’aides d’urgence. Une réponse structurelle s’impose, exigeant une révision profonde des politiques d’aménagement du territoire, l’investissement dans des infrastructures résilientes et la mise en œuvre de solutions innovantes, intégrant aussi bien l’ingénierie civile que la restauration des écosystèmes naturels capables de retenir et d’absorber les eaux de pluie. La résolution de cette crise chronique est un impératif de dignité et de développement durable pour les populations vulnérables. L'analyse des inondations récurrentes au Sénégal révèle moins une fatalité naturelle qu'un échec systémique et multiscalaire de gouvernance, de planification urbaine et de civisme. Cette situation est le fruit d'une convergence toxique entre des facteurs naturels, des décisions politiques court-termistes, une application laxiste des lois et une pression démographique et foncière mal gérée.
10. Selon vous, les politiques publiques menées jusque-là ont-elles été à la hauteur de ce fléau récurrent ?
Les récentes inondations qui ont frappé le pays ont clairement mis en lumière l’échec des politiques publiques en matière d’assainissement. Elles ont mis en évidence une vulnérabilité accrue de plusieurs communes pourtant considérées comme modèles d'aménagement. Les villes de Dakar, Thiès, Touba et Tambacounda qui ont été durement touchées sont illustratives de cet échec où des pluies diluviennes ont transformé les artères en véritables cours d'eau et submergé des quartiers entiers. Ces événements ont fini d’exposer les défaillances structurelles des politiques d'urbanisme et de gestion des risques. Le Sénégal dispose pourtant d’une expertise avérée mais aussi de plans qui sommeillent hélas dans le silence des tiroirs. La Direction de l'Aménagement du Territoire (DAT) et d'autres structures techniques disposent en effet d'une connaissance fine du risque et des catastrophes naturels. Elles ont produit des études hydrologiques et pluviométriques prospectives modélisant l'impact précis du changement climatique sur le bilan hydrique du pays. Des Schémas Directeurs d'Aménagement Urbain (SDAU) pour les grandes villes et des Plans d'Occupation des Sols (POS) pour les villes secondaires ont été conçus. Ces derniers intègrent une composante Gestion des Risques et Catastrophes (GRC) qui identifie les zones inondables (dites "zones rouges") et prescrit des règles d'urbanisme strictes. Le problème réside dans la non-application systématique de ces documents. Leur application tarde à se matérialiser par manque de volonté politique, de moyens dédiés ou sous la pression d'intérêts fonciers. Cela crée une irresponsabilité collective où chacun se renvoie la balle. La Direction des Constructions et les services techniques municipaux jouent pourtant un important rôle. Tout en délivrant les autorisations de construire, ils assurent également le suivi-contrôle s’agissant du respect du Code de l'Urbanisme et du Code de l'Environnement. Dans les faits, ce contrôle est malheureusement et notoirement laxiste, voire absent. On observe un usage abusif de l'espace public dans les lotissements de la quasi-totalité des zones urbaines du pays (empiètement sur les voies, remblaiement des zones basses). Une construction anarchique qui obstrue les écoulements naturels des eaux (drainages, vallées, exutoires). Le non-respect des cartes géotechniques qui indiquent pourtant la constructibilité des sols n’est pas en reste. Cette impunité généralisée engendre un effet de saturation du réseau hydraulique naturel et artificiel, transformant toute forte pluie en inondation.
L'échec des politiques publiques en matière d’urbanisme est d’autant plus patent que le cas des Parcelles Assainies est une parfaite illustration de la rupture entre l'intention et sa mise en œuvre. Le modèle rigoureux et exigeant d'origine (Années 60-80) porté par la SICAP et la SN-HLM, reposait sur le modèle d'aménagement intégral. Il suivait le schéma de lotissement intégralement assaini avant toute coupe de parcelle. Cette formule permettait de réaliser les travaux de drainage pour évacuer les eaux, puis d’installer les Voirie et Réseaux Divers (VRD) (eau potable, électricité, égouts). Le coût est certes élevé mais permet de garantir la qualité. Pour loger plus de monde à moindre coût, la Banque Mondiale avait promu un modèle progressif. L'idée était de créer des unités de voisinage où l'État installerait les équipements de façon progressive. L'État a reçu les financements mais a détourné l'objectif. Les cahiers des charges ont été tronqués, les travaux d'assainissement fondamentaux (drainage) réduits à peau de chagrin ou purement omis. Le principe fut inversé aboutissant à une simple allocation d’espaces. Le résultat est un oxymore : des Parcelles Assainies qui sont en réalité les premières à être inondées chaque hivernage. Les précipitations intensives d'août 2025 ainsi que les images de rues submergées et d'habitations infiltrées ont choqué l'opinion publique, révélant l'absence de réseaux d'assainissement face à l'intensification des phénomènes pluvieux. Ce modèle a été répliqué dans les années 1990 par Scat Urbam aux Maristes, entérinant l'échec.
11. Quelles solutions concrètes et durables le Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement propose pour prévenir et gérer efficacement les inondations ?
Notons que le Sénégal n'est pas condamné à subir éternellement ce fléau. Le pays dispose d’outils législatifs, de l'expertise technique et de financements nécessaires. Ce qui manque, c'est la volonté politique intransigeante de les appliquer en s'attaquant frontalement aux réseaux de spéculation et de corruption qui prospèrent sur le chaos urbain. Gérer les inondations, c'est avant tout faire le choix de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, de la planification à long terme sur le profit immédiat. C'est un choix de société qui engage l'avenir de millions de sénégalais. La solution nécessite ainsi une rupture avec les pratiques actuelles et une approche multidimensionnelle. Cela passera par la nécessité de restaurer l'autorité de l'État en tant que régulateur. Il s’agira de rendre les SDAU/POS opposables aux tiers et contraignants pour les maires. Tout permis de construire dans une zone rouge doit être juridiquement impossible. Il faudra en outre auditer et sanctionner les services de contrôle (Direction des Constructions, municipalités) qui délivrent des permis illégaux. La généralisation de l'usage de la télédétection pour surveiller l'urbanisation en temps réel et identifier les constructions illicites doit être promue. Ces mesures permettront de mettre un terme à l'impunité et restaurer le civisme. La mise en place de sanctions systématiques contre les constructions hors-la-loi (démolitions, amendes lourdes) et contre les responsables complices doit être envisagée tout comme des campagnes massives d'éducation civique sur les risques et le respect des règles d'urbanisme doivent être menées. L’implication des populations dans la gestion de proximité doit être mieux organisée (nettoyage des caniveaux, entretien des ouvrages). L’investissement dans des solutions durables et techniques permettant de désengorger les zones saturées par des politiques de décentralisation urbaine efficace doit être privilégié. Un programme national de drainage et de construction/d’entretien d'infrastructures hydrauliques (curage et création de canaux, mise en place de réseaux fonctionnels d’assainissement en fonction des données démographiques et de leur expansion future, bassins de rétention, station de pompage dans les points critiques (e.g., Guédiawaye, Pikine) devrait voir le jour. Des soutions fondées sur la nature doivent être appliquées permettant de protéger les Niayes et autres zones humides afin qu’elles agissent comme des éponges naturelles.
12. Votre parti envisage-t-il de mettre en place une politique de planification urbaine plus stricte pour limiter les dégâts liés aux pluies diluviennes ?
Absolument. Notre parti envisage, avec une détermination inflexible, d'instaurer une politique de planification urbaine radicalement plus stricte et exigeante, considérant que l'urbanisme est la pierre angulaire de l’habitat mais aussi de la lutte contre les catastrophes climatiques récurrentes. Il ne s'agira plus de produire de simples documents d'intention, mais d'imposer des schémas directeurs et des plans locaux d'urbanisme réellement opposables à tous, intégrant une cartographie impérative des zones inondables et des risques, et dont le respect sera scrupuleusement contrôlé par des services techniques dotés de moyens coercitifs renforcés. Cette rigueur s'incarnera par un moratoire immédiat sur toute construction en zone rouge et la promotion obligatoire d'infrastructures résilientes inspirées des modèles de « ville éponge » (bassins de rétention, revégétalisation, désimperméabilisation des sols) pour absorber et gérer les eaux pluviales in situ plutôt que de les subir. Enfin, cette nouvelle gouvernance urbaine, décentralisée mais strictement encadrée par un système de suivi et de contrôle plus effectif, visera à briser le cercle vicieux de la spéculation foncière et de la corruption qui, trop souvent, ont primé sur l'intérêt général et la sécurité des populations.
13. Quelle est votre appréciation globale du référentiel Sénégal 2050 proposé par le gouvernement ?
Le référentiel Sénégal 2050, présenté comme l'Agenda national de transformation destiné à remplacer le Plan Sénégal émergent (PSE), suscite un scepticisme quant à sa crédibilité et sa faisabilité. Cette vision, pourtant ambitieuse sur le papier, pêche par des incohérences stratégiques, des modalités de financement irréalistes et une absence de lisibilité dans un contexte socio-économique extrêmement dégradé. Le Gouvernement envisage que 65% du financement de cette vision soit assuré par le secteur privé national. Cette hypothèse apparaît particulièrement hasardeuse au regard de la situation actuelle des entreprises sénégalaises. Comme le souligne le diagnostic du référentiel lui-même, 90% des entreprises sont de très petite taille (générant moins de 100 millions FCFA de chiffre d'affaires annuel) et l'économie est dominée par un secteur informel qui ne bénéficie d'aucune protection sociale structurelle. Compter sur un secteur privé aussi fragile pour porter les investissements nécessaires relève de l'angélisme économique, d'autant que le rapport de la Cour des Comptes a révélé un déficit public historiquement élevé (10,4% du PIB en moyenne entre 2019-2023) et une dette publique qui atteint 99,7% du PIB pour la même période, limitant drastiquement la capacité de l'État à impulser une dynamique vertueuse. La Vision Sénégal 2050 a été présentée en grande pompe en octobre 2024 comme un cadre prospectif intégrant une transformation systémique sur 25 ans. Or, à peine dix mois plus tard, en août 2025, le Gouvernement a dévoilé un Plan de Redressement Économique et Social (PRES) aux accents urgents, reposant essentiellement sur une fiscalité agressive pour mobiliser 5 600 milliards FCFA d'ici 2028. Ce revirement stratégique soulève des questions fondamentales : pourquoi un plan de long terme nécessite-t-il dans la foulée un correctif aussi brutal ? Les mesures annoncées – taxation du mobile money à 130 milliards FCFA, imposition des paris en ligne à 70%, doublement de la taxe sur le tabac à 100% ainsi que les redressements fiscaux brutaux ciblant les ménages (comme les notifications de 15 à 30 millions FCFA envoyées aux propriétaires), trahissent une improvisation et une rupture avec l'ambition transformative initiale. Cette incohérence donne l'impression d'un gouvernement contraint de « recoller les pots cassés" plutôt que de déployer une vision lisible et stable. Le contexte dans lequel évolue ce référentiel est particulièrement alarmant : croissance atone (4,1% en 2023, 4,5% prévue en 2024), inflation persistante (5,9% en 2023), et pauvreté endémique (40% de la population sous le seuil de pauvreté). Dans ce cadre, la Vision 2050, accusée par ses détracteurs d'être "étrangement déconnectée de la réalité" , ne propose aucun plan concret pour soulager immédiatement les ménages confrontés à la hausse des prix des produits de première nécessité. Pire, le plan de redressement qui l'accompagne risque d'aggraver les tensions sociales via une pression fiscale accrue sur les citoyens et les très petites entreprises, sans garantie de contreparties en termes de services publics ou d'investissements productifs. L'absence de clarification sur la soutenabilité de la dette (classée à risque "élevé" par le FMI) et les inquiétudes sur la gouvernance (nominations politiques clivantes au ministère de l'Intérieur et de la Justice) ajoutent à l'opacité de la trajectoire gouvernementale. En définitive, le référentiel Sénégal 2050 inspire le scepticisme car il semble ignorer les contraintes immédiates qui hypothèquent sa propre réalisation. Vouloir bâtir une transformation systémique sur 25 ans en s'appuyant sur un secteur privé atone et en recourant à des mesures fiscales agressives à court terme relève du paradoxe. Le Gouvernement donne malheureusement l'impression de raconter des histoires sans parvenir à incarner une rupture crédible avec les erreurs passées. Sans assainissement préalable des finances publiques, sans consensus social sur la fiscalité et sans vision claire du financement endogène, la Vision 2050 qui semble avoir rejoint le silence de ces nombreux plans "savamment concoctés" qui ont, par le passé, réduit les Sénégalais à l'état de "cas sociaux" .
14. Pensez-vous que ce document reflète réellement les priorités et aspirations du peuple sénégal
Pensez-vous que ce document reflète réellement les priorités et aspirations du peuple sénégalais ?
Assurément, l'interrogation soulevée quant à la capacité du document Vision 2050 à capter l'essence des priorités et aspirations du peuple sénégalais mérite une analyse nuancée pour deux raisons. D’abord, l’on notera que dans l'ensemble, la Vision 2050 semble, a priori, refléter les aspirations légitimes de la nation. Ses objectifs déclarés, souvent nobles et ambitieux, s'alignent sur une volonté de prospérité, de stabilité et de progrès social que partage incontestablement une grande partie de la population. Toutefois, et c'est en cela que réside son défaut majeur, la Vision 2050 échoue dans l'appréhension pragmatique des solutions aux problèmes socio-économiques structurels. Ensuite, le PRES devant être financé à 90% par des ressources internes en signe de velléité de souveraineté financière qui contraste pourtant avec des sollicitations ultérieures auprès de partenaires internationaux. Le Gouvernement se rend compte que sa stratégie de miser sur une rationalisation des dépenses publiques et un élargissement de l'assiette fiscale ainsi que sur le recyclage d'actifs publics sans transfert de propriété bute sur des réalités structurelles incontournables. Un service de la dette représentant 23 273,4 milliards FCFA et un déficit courant persistant dans un contexte d’arrêt de l'aide américaine (USAID) creuse le déficit de financement critique pour plusieurs secteurs. Cette apparente contradiction pourrait à la limite relever d'un pragmatisme éclairé si elle s’inscrivait dans un modèle économique. La réussite de cette approche duale dépendra ultimement de la capacité effective de l’Etat à générer les recettes internes promises et à nouer des partenariats extérieurs n'alourdissant pas la dette publique. En attendant, la souffrance sociale que vivent les Sénégalais est palpable. Elle est marquée par un chômage de masse, la précarité et le coût élevé de la vie qui en sont malheureusement l'illustration parfaite et tragique. S’agissant de la Vision 2050, un hiatus manifeste se creuse entre la grandeur des ambitions proclamées et la dure réalité du quotidien. En effet, les solutions proposées par la Vision 2050 apparaissent non seulement en profond décalage avec les capacités et la vision des institutions et acteurs en charge de leur mise en œuvre, mais elles pêchent également par leur abstraction. Ces propositions ne s'inscrivent dans aucun modèle économique rigoureux ni dans aucune politique économique clairement définie et chiffrée, ce qui empêche d'en garantir la cohérence intrinsèque, la faisabilité et, in fine, la réussite. Ainsi, si le reflet des aspirations est peut-être présent dans le miroir des intentions, la fracture devient criante lorsque l'on considère l'absence de chemin concret et crédible pour les réaliser, laissant les citoyens sénégalais dans l'expectative et face à de douloureuses réalités socio-économiques.
15. Le Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement adhère-t-il à cette vision de long terme ou compte-t-il proposer une alternative propre à son projet politique ?
Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement aborde la question de la Vision 2050 avec un regard des plus critiques. Si nous souscrivons naturellement à la nécessité impérieuse d'une ambition nationale de long terme, nous ne saurions en revanche adhérer à une vision dont la conception même semble porteuse des germes de son propre échec, comme en attestent les lacunes structurelles que nous avons déplorées plus haut. Notre parti propose, à l'inverse, une formule alternative radicalement distincte, fondée sur une méthodologie axiologique rigoureuse. Cette approche procède par enchaînement logique et inexorable : elle s'établit d'abord sur la définition concertée d'un modèle de développement incarnant les valeurs cardinales de la société sénégalaise. Ce modèle détermine la finalité de notre projet sociétal. Ce dernier inspire et commande ensuite l'élaboration d'un modèle économique robuste, conçu comme son unique traduction opérationnelle en termes de création et de répartition de la richesse. Ce n'est qu'en dernier lieu que ce modèle économique se décline en une politique économique précise, un corpus cohérent de mesures et d'instruments concrets. C'est en inscrivant notre démarche dans cette logique ascendante et vertueuse – du philosophique vers l'opérationnel – que nous serons à même de générer une prospérité partagée et de financer l’ensemble de nos politiques publiques de manière pérenne, à la juste satisfaction des légitimes attentes des citoyens sénégalais.
ANTA FOFANA