Abdoulaye Ba, spécialiste des systèmes d’information, de la donnée et de l’aide à la décision : La diaspora ne doit pas être un acteur périphérique : elle doit être au cœur de la stratégie nationale d’innovation.
Monsieur Abdoulaye Ba, un profil rare et complet : diplômé d’un Master MIAGE, spécialiste des systèmes d’information, de la donnée et de l’aide à la décision, il a construit sa carrière au cœur des secteurs les plus sensibles et les plus encadrés : finance d’investissement, audit, fiscalité, télécommunications internationales.
Pendant plus de dix ans, il a évolué au Luxembourg, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Inde et en Afrique du Nord, menant notamment des projets de conformité RGPD pour des institutions financières et des cabinets de premier plan.
En 2024, il rejoint Orange Business France & International où il occupe un rôle stratégique et nouveau : Consultant en Éthique de l’Intelligence Artificielle. Sa mission ? Créer de la valeur à partir de l’IA tout en maîtrisant les risques et en anticipant les contraintes réglementaires, dont l’EU AI Act, qui fera jurisprudence dans le monde.
Originaire du Sénégal, Abdoulaye se retrouve au croisement d’enjeux mondiaux : responsabilité technologique, souveraineté numérique, gouvernance de la donnée et équité d’accès au digital.
C’est ce regard international, ancré dans une identité sénégalaise assumée, qui fait de lui une voix importante dans le débat sur l’IA, l’Afrique, la diaspora, et l’avenir du numérique sur le continent.
On parle beaucoup d’IA partout dans le monde, parfois avec enthousiasme, parfois avec peur. Vous, qui êtes au cœur du sujet : c’est quoi la réalité aujourd’hui ? Est-ce que l’IA est déjà en train de changer le monde, ou est-ce qu’on est encore au tout début de l’histoire ?
L’IA n’est pas un phénomène nouveau. Elle existe depuis les années 1950 — à l’époque, on rêvait déjà de machines capables de raisonner comme l’humain.
Ce qui change aujourd’hui, c’est son niveau de maturité et sa diffusion dans tous les aspects de notre vie quotidienne.
Elle n’est plus réservée aux laboratoires de recherche : elle résume et traduit nos textes, synthétise nos réunions, trie nos emails, gère la sécurité dans les lieux publics, analyse nos émotions et comportements en ligne, et commence à transformer des secteurs entiers comme la santé, la finance ou l’éducation.
On ne parle donc pas d’un concept en devenir, mais d’une réalité déjà bien installée.
L’IA n’est plus un sujet de demain : elle agit déjà sur la manière dont nous travaillons, apprenons et interagissons.
La vraie question n’est plus “quand” elle changera le monde, mais comment nous allons l’encadrer pour qu’elle le change dans le bon sens — c’est-à-dire au service de l’humain, de la justice et du progrès collectif.
Vous occupez un poste particulier : vous êtes spécialisé dans l’éthique de l’IA. Comment expliquer, très simplement, à un lecteur sénégalais ou africain, en quoi l’éthique va devenir centrale dans l’IA moderne et pourquoi il faut s’en soucier dès maintenant ?
Aujourd’hui, les algorithmes décident de plus en plus à notre place : ils recommandent ce que nous lisons, filtrent ce que nous voyons, ou orientent nos choix professionnels et médicaux.
Sans cadre éthique, ces décisions peuvent devenir invisibles, partiales, voire dangereuses.
Une IA ne doit jamais prendre de décision autonome à la place de l’humain. Elle doit éclairer, accompagner, proposer — mais c’est toujours à l’humain de décider.
Mais l’éthique ne concerne pas seulement la justice ou la vie privée : elle concerne aussi le bien-être global des utilisateurs et la planète.
Former, héberger et faire tourner des modèles d’IA consomme énormément d’énergie et d’eau. Dans un continent où l’accès à l’électricité et à l’eau reste un défi, cette question environnementale devient centrale.
Développer une IA responsable en Afrique, c’est donc penser efficacité énergétique, sobriété numérique et impact environnemental.
L’éthique de l’IA, au fond, c’est une question de responsabilité :
- responsabilité envers l’humain, pour qu’aucune machine ne décide à sa place ;
- responsabilité sociale, pour que les usages technologiques ne creusent pas les inégalités ;
- et responsabilité environnementale, pour que l’innovation ne se fasse pas au détriment des ressources vitales du continent.
Est-ce que demain un élève au Sénégal pourra bénéficier du même niveau d’accompagnement qu’un élève en Europe, grâce à l’IA ?
C’est tout à fait possible.
L’IA permet déjà de créer des tuteurs virtuels qui s’adaptent au niveau, à la langue et au rythme de chaque élève.
Un enfant à Thiès ou à Louga pourrait, demain, avoir accès à un apprentissage personnalisé sans dépendre du nombre d’enseignants disponibles.
Mais avant d’en arriver là, il faut résoudre la fracture numérique.
Beaucoup d’écoles au Sénégal — et plus largement en Afrique — manquent encore d’accès stable à Internet, d’ordinateurs, ou même d’électricité régulière.
Parler d’IA sans régler la question de la connectivité, c’est comme vouloir construire une maison sans fondations.
Il faut d’abord garantir un accès équitable aux infrastructures numériques, former les enseignants à ces nouveaux outils, et mettre en place une gouvernance éducative capable d’encadrer l’usage de la donnée scolaire.
Ce n’est qu’à ce moment-là que l’IA pourra jouer pleinement son rôle : réduire les inégalités éducatives et offrir à chaque élève, où qu’il soit, les mêmes chances d’apprendre et de réussir.
De manière très concrète : que faudrait-il changer immédiatement dans le système éducatif sénégalais pour que nos jeunes ne soient pas “consommateurs de technologie”, mais bien “créateurs de technologie” ?
Il faut changer la manière d’enseigner.
Aujourd’hui, on apprend encore trop souvent à utiliser des outils, au lieu d’apprendre à les comprendre.
Être créateur de technologie, ce n’est pas seulement savoir cliquer — c’est savoir pourquoi et comment les choses fonctionnent.
L’école doit enseigner la logique, la pensée algorithmique, la créativité numérique, mais aussi l’esprit critique face aux technologies.
Vous savez, les plateformes de réseaux sociaux ne montrent pas les mêmes contenus selon les pays ou les continents.
Prenez l’exemple de TikTok : en Asie, la plateforme met en avant des contenus éducatifs, scientifiques, culturels.
En Afrique, malheureusement, on y voit surtout du divertissement.
Cela me peine, car cela montre à quel point nos jeunes sont plus souvent ciblés comme consommateurs de contenus, plutôt qu’encouragés à devenir des producteurs de savoir ou d’innovation.
Il faut donc redonner aux jeunes le goût de créer : coder, expérimenter, inventer.
Et surtout leur faire comprendre que la technologie n’est pas un spectacle, c’est un outil de transformation.
Le service public africain, et sénégalais en particulier, souffre souvent de lenteur, de bureaucratie, de manque d’efficacité. Est-ce que l’IA peut aider à moderniser l’administration ? Quels cas d’usage réalistes voyez-vous dans le court terme ?
Oui, l’IA peut véritablement transformer le service public — pas dans dix ans, mais dès maintenant.
Elle peut fluidifier la relation entre l’État et les citoyens, accélérer le traitement des dossiers et réduire les lourdeurs administratives qui freinent encore trop souvent les démarches quotidiennes.
Concrètement, on peut imaginer :
• Des chatbots administratifs capables de répondre aux questions des citoyens 24h/24 : suivi de dossier, documents à fournir, prise de rendez-vous, etc. Cela libérerait du temps aux agents et permettrait aux usagers d’obtenir des réponses instantanées, même en dehors des heures d’ouverture.
• Des assistants IA capables de trier, d’analyser et de prioriser les demandes — qu’il s’agisse d’une réclamation, d’une demande de carte d’identité ou d’un dossier de permis. Ces outils peuvent aussi détecter automatiquement les doublons ou les erreurs, ce qui évite des semaines de retard.
• Dans le foncier, l’IA peut accélérer la vérification de l’authenticité des titres de propriété, comparer les registres, repérer les anomalies et prévenir les litiges.
• Dans la justice, elle peut offrir un appui considérable aux magistrats et aux greffiers en facilitant l’accès rapide à des bases documentaires volumineuses : jurisprudence, textes légaux, archives. Cela améliore la rapidité et la cohérence des décisions rendues.
Mais il faut préciser une chose : l’IA ne remplacera pas le fonctionnaire, elle l’assiste.
Elle automatise les tâches répétitives pour que les agents se concentrent sur ce qui demande du jugement, de l’écoute et du discernement humain.
C’est comme cela qu’on peut construire une administration à la fois plus rapide, plus juste et plus proche du citoyen.
5 – Les grandes puissances mondiales vivent une véritable bataille autour de la donnée et des modèles d’IA. Est-ce que l’Afrique risque de devenir dépendante technologiquement des autres ? Et comment peut-elle protéger sa souveraineté sur ses propres données ?
Oui, le risque est réel.
Aujourd’hui, la donnée est le nouveau moteur de la puissance économique et stratégique. Celui qui contrôle la donnée contrôle la valeur, l’innovation et même la capacité de décision.
Regardons l’exemple de la France et de l’Europe : certaines données dites “souveraines” ou issues des opérateurs d’importance vitale (OIV) — comme celles de la défense, de la santé ou de l’énergie — ne peuvent pas sortir du territoire européen.
Les fournisseurs d’IA qui veulent collaborer avec ces secteurs sont obligés d’héberger leurs données dans des datacenters situés en Europe, et de respecter des normes strictes de sécurité et de confidentialité.
C’est une façon très concrète de protéger la souveraineté numérique et d’éviter que des informations sensibles ne tombent sous des juridictions étrangères.
L’Afrique, elle aussi, doit adopter cette logique.
Il ne suffit pas de produire des données : il faut les stocker localement, les traiter localement et les protéger par un cadre légal solide.
Cela passe par des infrastructures de confiance, des datacenters régionaux, des réglementations cohérentes et surtout une vision commune entre États africains.
Si les données africaines continuent d’être hébergées ou traitées ailleurs, le continent restera dépendant des puissances étrangères pour sa propre intelligence.
Mais s’il construit une gouvernance forte de la donnée, l’Afrique pourra non seulement préserver sa souveraineté, mais aussi créer sa propre valeur et son indépendance technologique.
L’IA soulève aussi un débat sur la sécurité : manipulation informationnelle, deepfakes, cybercriminalité plus sophistiquée… L’Afrique est-elle prête à faire face à ces nouveaux risques ?
La prise de conscience progresse, mais la préparation reste inégale.
Les menaces évoluent beaucoup plus vite que les moyens de défense.
On parle souvent de désinformation, de deepfakes ou de cyberattaques, mais un sujet qu’on évoque rarement, c’est l’espionnage industriel.
Les solutions d’IA, comme tout système informatique, peuvent présenter des failles de sécurité.
Un acteur malintentionné peut exploiter ces vulnérabilités pour accéder à des données confidentielles, détourner des modèles ou provoquer des fuites d’informations sensibles.
C’est pour cela qu’il faut évaluer la robustesse de chaque solution d’IA avant de la déployer, surtout dans les secteurs critiques comme la santé, la finance, la défense ou les infrastructures publiques.
La sécurité ne doit pas être un ajout après coup, mais une composante intrinsèque de la conception de l’IA.
Face à ces défis, les pays africains doivent renforcer leurs capacités de cybersécurité, créer des équipes d’audit spécialisées dans la sécurité des systèmes d’IA et former des experts capables de détecter et d’anticiper les nouvelles menaces.
Mais il faut aussi développer une culture du risque numérique : savoir qu’un outil intelligent n’est pas infaillible, et que la vigilance humaine reste la première ligne de défense.
Tout le monde parle d’innovation… mais très peu parlent de gouvernance. Comment bâtir des institutions solides, capables de piloter la transformation numérique et d’assurer qu’elle profite à tous, pas seulement à quelques élites ?
La gouvernance, c’est la colonne vertébrale du numérique.
Sans elle, l’innovation devient chaotique, fragmentée, parfois même contre-productive.
Mais une bonne gouvernance, ce n’est pas une bureaucratie de plus : c’est un cadre qui donne confiance, clarifie les responsabilités et permet à l’innovation d’évoluer dans un environnement sûr et cohérent.
Dans mes activités, mon objectif est justement d’accompagner mes clients à mettre en place une gouvernance qui accélère le progrès, tout en respectant la régulation — et non une gouvernance qui le freine.
L’idée n’est pas d’imposer des contraintes, mais d’instaurer des garde-fous intelligents : des processus clairs, une traçabilité des décisions, et une transparence dans l’usage des données et des algorithmes.
Pour qu’une transformation numérique profite à tous, il faut des institutions solides, des décideurs formés et des mécanismes de contrôle efficaces.
Cela passe aussi par une collaboration ouverte entre l’État, les entreprises et les chercheurs.
C’est à cette condition que la gouvernance ne sera pas perçue comme un frein, mais comme un moteur de confiance et de progrès durable.
Vous êtes vous-même issu d’une diaspora talentueuse. Comment voyez-vous le rôle de cette diaspora dans la construction d’un écosystème IA au Sénégal ? Doit-elle être un partenaire, un investisseur, un mentor… ou tout cela à la fois ?
Je suis profondément admiratif de la diaspora sénégalaise.
Partout où je me suis déplacé dans le monde — en Europe, aux États-Unis, en Asie ou dans le Golfe — j’ai vu des Sénégalais respectés, compétents, et occupant des postes de grande responsabilité.
Cette diaspora est une fierté. Elle est la preuve vivante que le talent sénégalais s’impose par la compétence, la rigueur et la résilience.
Mais au-delà de la réussite individuelle, la diaspora doit jouer un rôle collectif.
Elle peut être partenaire, mentor, investisseur et relais d’influence à la fois.
Elle dispose d’une double richesse : la connaissance des standards internationaux et la compréhension profonde des réalités locales.
C’est cette combinaison qui peut accélérer le développement d’un véritable écosystème de l’intelligence artificielle au Sénégal.
Il ne s’agit pas seulement de transférer des compétences, mais aussi de co-construire des projets, d’encourager les échanges, et de créer des ponts durables entre les talents de l’extérieur et ceux du pays.
La diaspora ne doit pas être un acteur périphérique : elle doit être au cœur de la stratégie nationale d’innovation.
Le gouvernement sénégalais a décidé de consacrer une journée, le 17 décembre, à la diaspora. En tant que membre de cette diaspora : que représente ce choix pour vous ? Et qu’en attendez-vous concrètement ?
C’est une belle reconnaissance symbolique.
Mais au-delà du geste, cette journée doit devenir un point de convergence entre les talents de la diaspora et les priorités nationales.
La diaspora n’est pas un groupe à part : c’est une force vive du pays, une extension de son intelligence collective à travers le monde.
Je vois aujourd’hui de nouvelles initiatives portées par des membres de la diaspora pour cartographier les compétences sénégalaises à l’étranger et favoriser les réseaux d’expertise sectorielle.
Ces démarches sont précieuses, car elles permettent de visualiser où se trouvent nos forces, nos talents, nos leviers d’action.
Elles créent des passerelles concrètes entre des Sénégalais établis à l’international et des institutions, des startups ou des universités du pays.
Le gouvernement devrait se rapprocher davantage de ces acteurs — pas pour les encadrer, mais pour travailler avec eux, main dans la main.
L’État doit voir la diaspora non pas comme un symbole, mais comme un partenaire stratégique du développement.
Une journée dédiée à la diaspora n’a de sens que si elle s’accompagne d’initiatives concrètes : fonds de soutien, plateformes de collaboration, et intégration réelle de l’expertise issue de l’extérieur dans les politiques publiques.
Un Sénégal en 2040 où l’IA serait un moteur de développement : comment vous l’imaginez ? Quelle serait votre vision d’un Sénégal numérique réussi, concret, visible dans la vie de tous les jours ?
Je rêve d’un Sénégal où la technologie est au service du bien-être collectif, pas de la performance individuelle.
Un pays où les démarches administratives sont simples et transparentes, où les écoles utilisent l’IA pour accompagner chaque élève selon ses besoins, où la donnée devient un bien public protégé et valorisé.
Un Sénégal où les agriculteurs, les médecins, les entrepreneurs et les fonctionnaires utilisent des outils intelligents conçus localement pour résoudre des problèmes locaux.
Mais au-delà de ça, mon rêve serait de voir un Sénégal qui ne consomme pas seulement la technologie, mais qui l’exporte.
Un pays capable de produire ses propres solutions d’intelligence artificielle, reconnues et utilisées à l’échelle mondiale.
Un Sénégal leader de l’innovation éthique et responsable, qui inspire d’autres nations par sa capacité à allier technologie, humanité et vision.
Pour y arriver, il faudra investir dans la recherche, valoriser les talents, protéger la donnée nationale et instaurer une culture de l’excellence.
Un Sénégal numérique réussi, ce serait un pays où la technologie rapproche, élève et rend fier.
Un pays qui prouve qu’on peut être à la fois connecté au monde et fidèle à ses valeurs.
Entretien : Malick Sakho








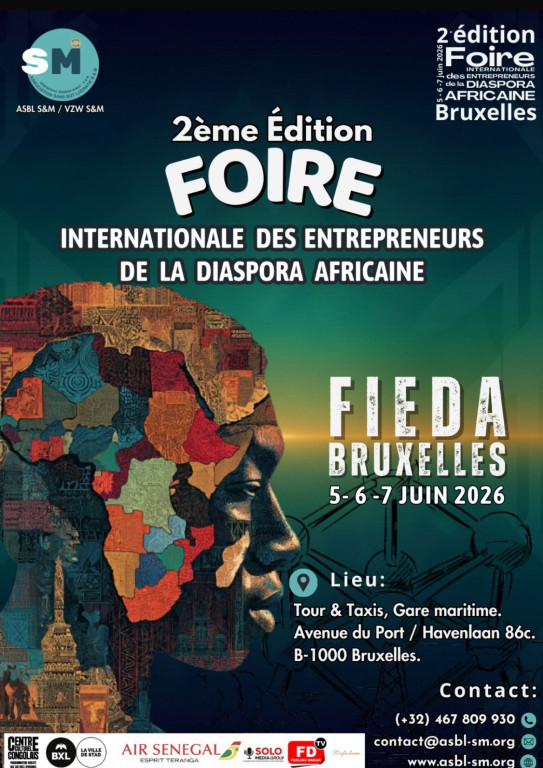

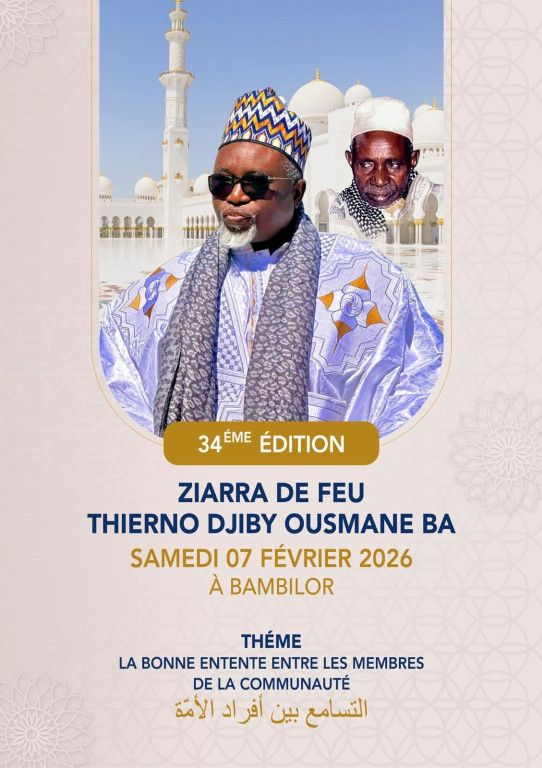
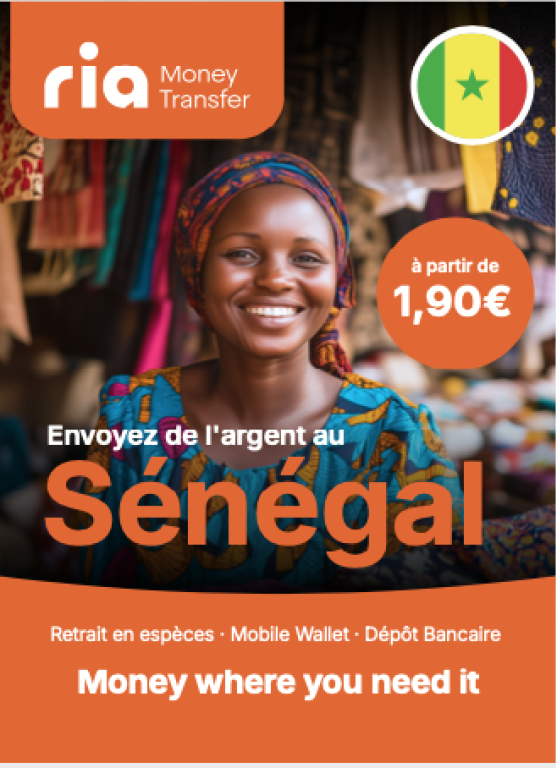

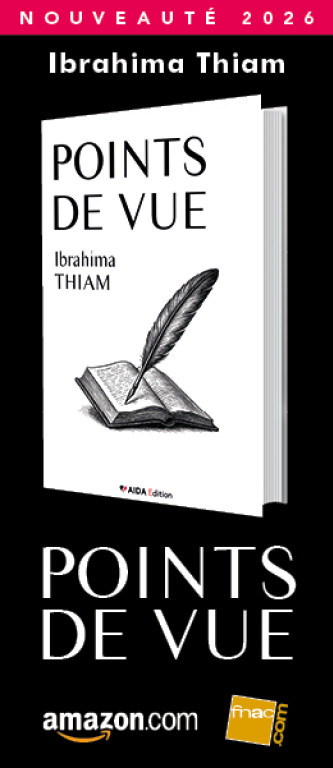

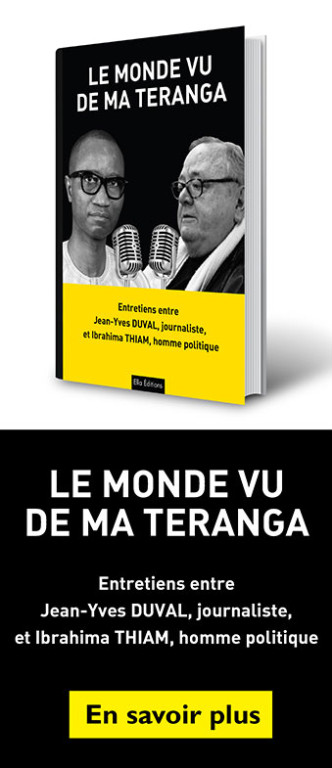

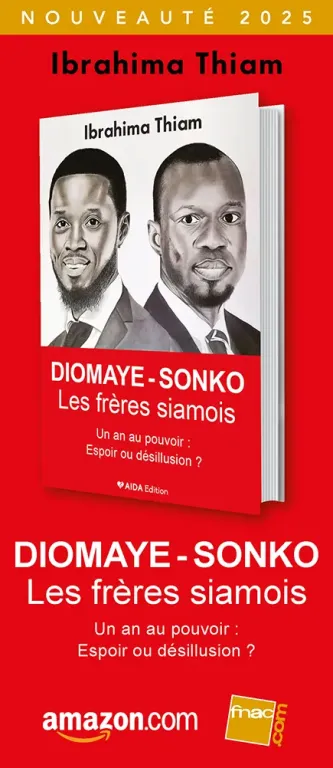
En lisant cet entretien sur l’intelligence artificielle effectué par Mr Ba , je me suis tourné directement sur les défis auxquels l’Afrique est confronté et doit faire face pour que L’IA serait le levier pour promouvoir le développement du continent africain.