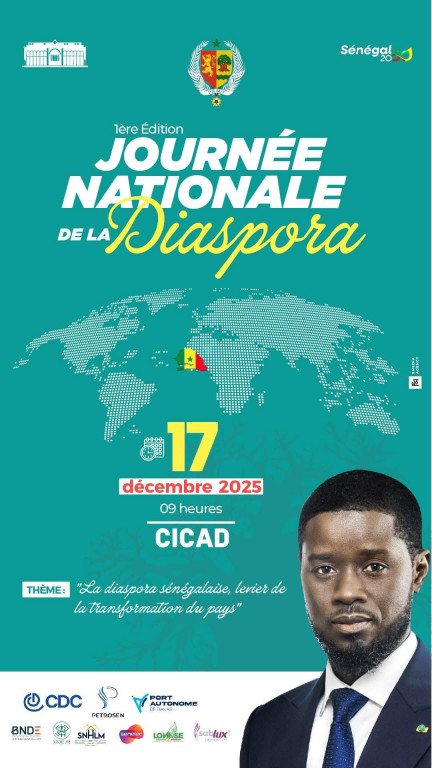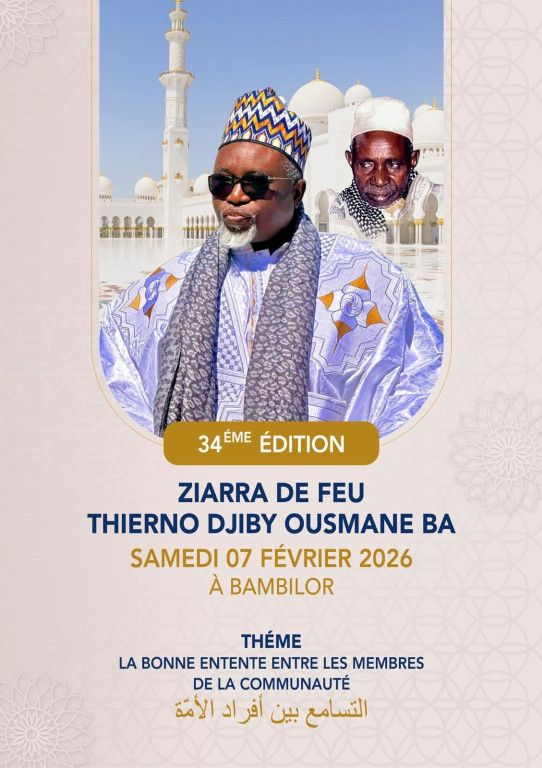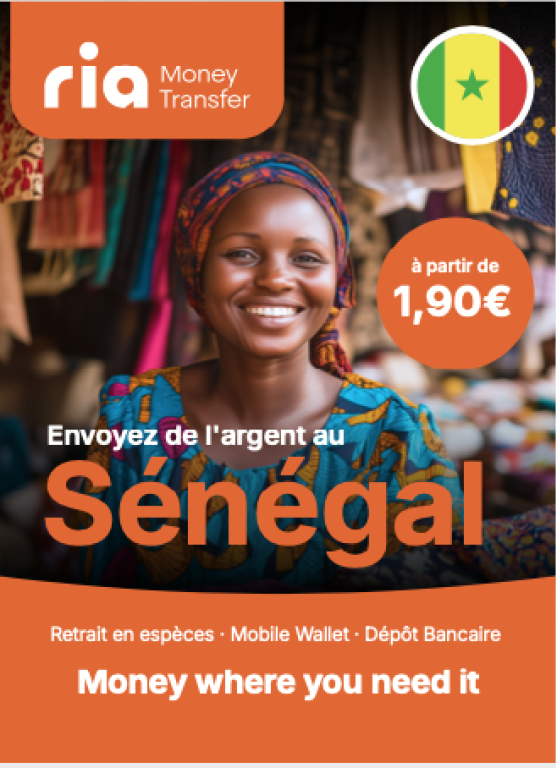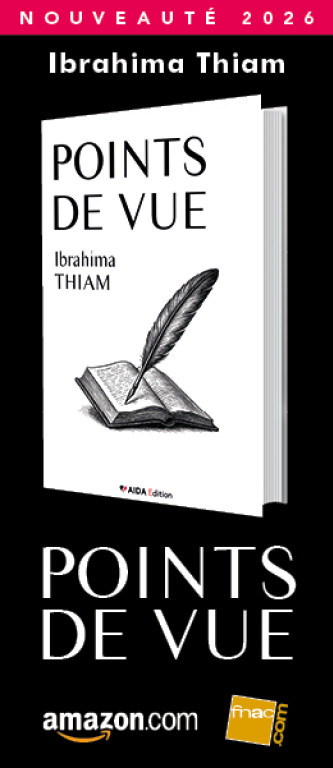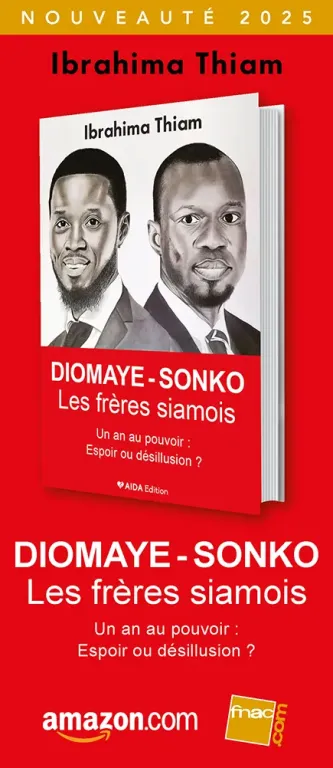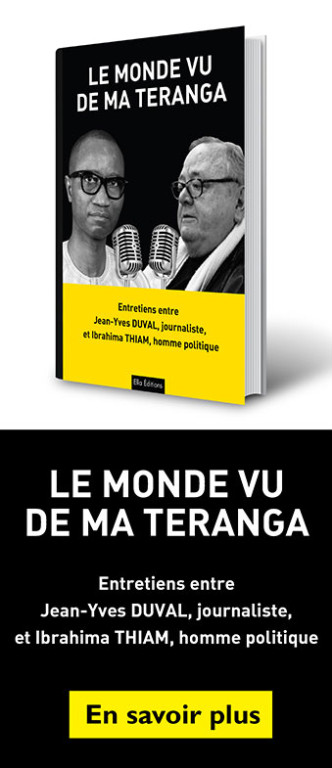Référendum hydrique: OUI/NON (à la) SDER (Mon bulletin "blanc")
Dans certaines parties du département de Linguère, les forages sont désormais l'épicentre d'une bataille existentielle : l'eau, patrimoine inaliénable ou simple commodité? Le rejet catégorique opposé par des communautés vîllageoises à la SDER (Sénégalaise des Eaux/ rural) semble dépasser une émeute sporadique. Il est assimilable à un manifeste politique, un cri sourd adressé au "nouveau Sénégal" : l’État saura-t-il discerner la sagesse de ceux dont l'expertise est avérée, ou imposera-t-il un modèle qualifié de "prédation hydrique" par ses détracteurs ?
Une évidence s'impose, pourtant, à l'observateur impartial. Depuis 2003, nombre d'ASUFOR (Association d'Usagers de Forages) et comités de pilotage (COPIL) – sans être universels – ont incarné une autogestion vertueuse. Vingt-deux années de gouvernance autonome attestent d'une compétence locale irréfutable : approvisionnement régulier en eau potable, irrigation agricole soutenable et abreuvement du bétail assuré sans défaillance majeure. Cette réussite procède d'investissements communautaires substantiels – plusieurs millions de FCFA autofinancés pour des systèmes solaires ou des pompes de secours, entre autres. Une performance qui suscite cette interrogation lancinante : "Pourquoi démanteler un système ayant fait ses preuves ?"
Face à cette impasse, l'État se doit d'impulser des réformes structurelles audacieuses. Trois nous paraissent impératives.
Premièrement, consacrer les réussites locales. Par une délégation pérenne formalisée par contrat aux ASUFOR/COPIL performants, assortie d'un label communautaire contrôlé par audits indépendants. C'est une façon de reconnaitre l'excellence là où elle a germé.
Deuxièmement, transformer la SDER d'opérateur centralisateur en appui technique décentralisé : guichets départementaux assurant la fourniture urgente de pièces détachées, et instauration d'un fonds de solidarité hydrique cofinancé (majoritairement par l’État, complété par les usagers et bailleurs), cogéré par un comité paritaire (État / ASUFOR-COPIL).
Troisièmement, instituer une justice tarifaire par l'application d'un barème progressif (par exemple : 50 FCFA/m³ pour les premiers 10 m³ vitaux ; 150 FCFA/m³ au-delà) et la gratuité des branchements pour certains services essentiels (écoles, lieux de culte, groupements féminins, structures sanitaires).
Ce triptyque ne relève point de l'utopie. Il procède d'une reconnaissance par l’État d'une évidence tangible : la seule privatisation acceptable serait celle de l'intelligence collective, non de la ressource elle-même.
Chaque brassard rouge brandi en signe de défiance est un stéthoscope posé sur le cœur alangui de notre gouvernance. L'enjeu désormais transcende la technique et l'économie : l'eau rurale (s'é)coulera-t-elle vers la dignité ou l'humiliation ? La réponse, s'écrivant en trois lettres incandescentes aux lèvres des assoiffés de justice est : É-C-O-U-T-E.
Oui, si l’État consent à entendre, le murmure des forages pourra devenir la mélodie d'un Sénégal renaissant par ses terroirs. Car un peuple qui maîtrise son eau, maîtrise son destin.
Moussa NDIAYE Maire de la commune de Thiamène Pass