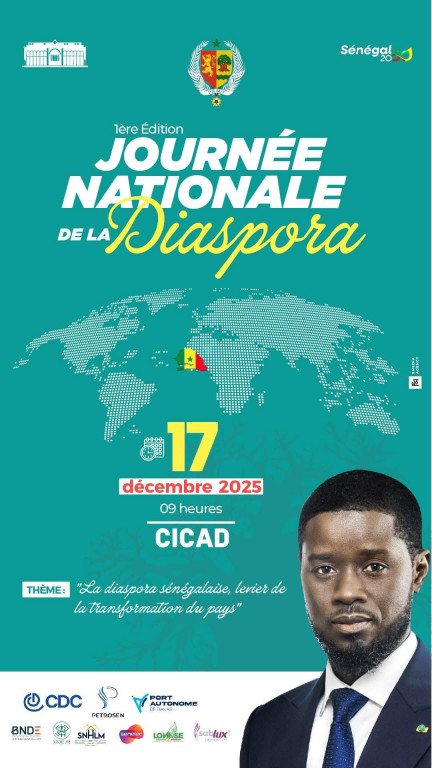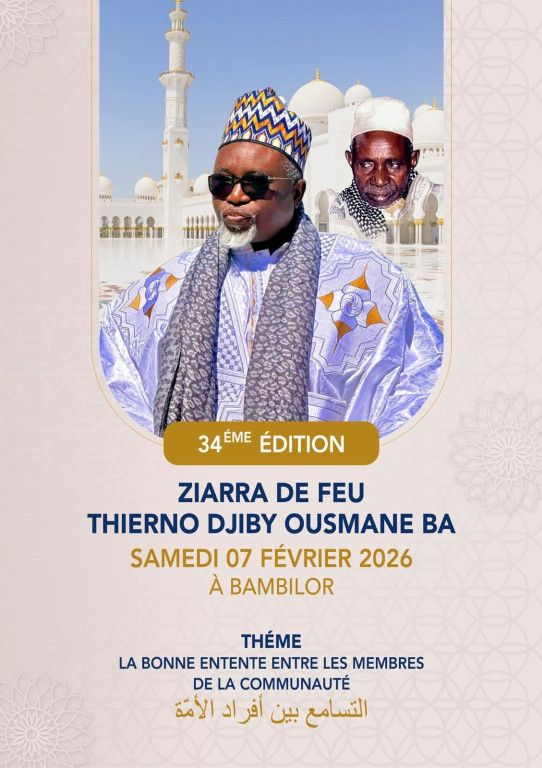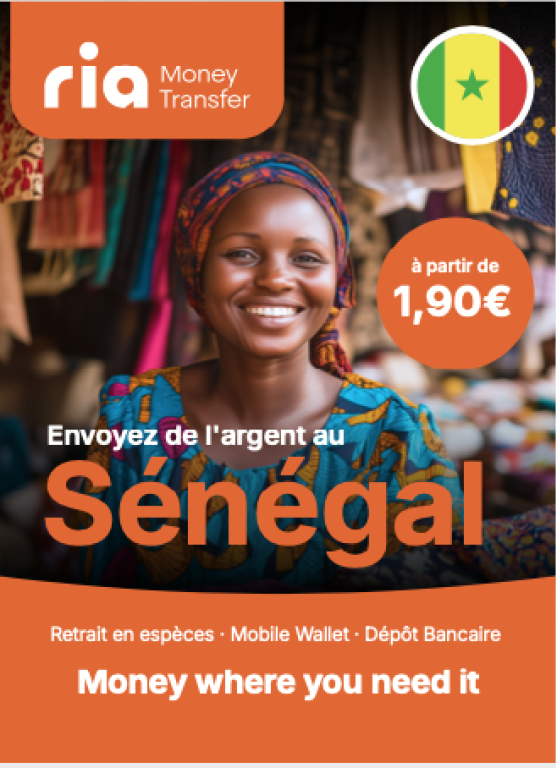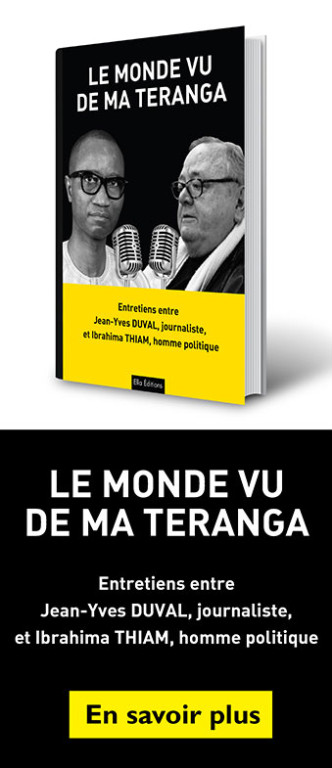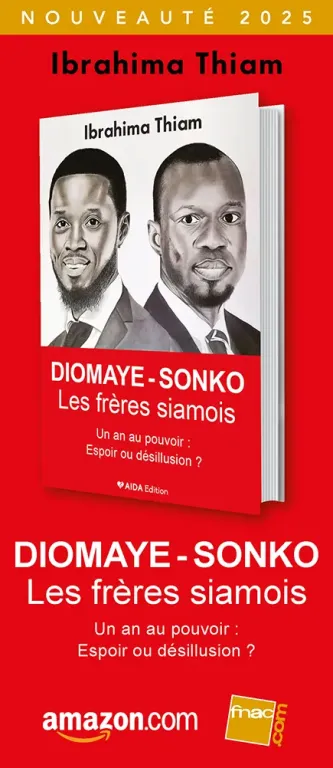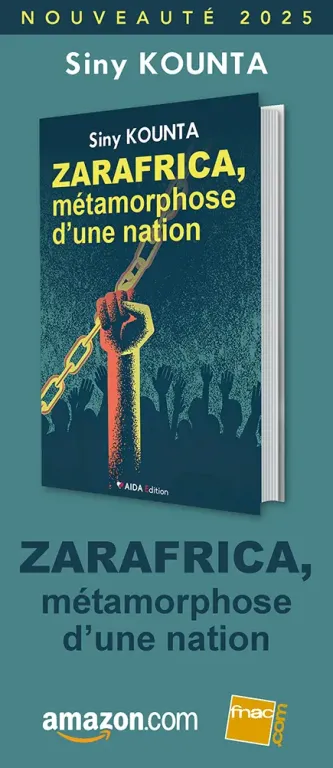Diaspora bonds : patriotisme économique ou illusion comptable ?
Les diaspora bonds apparaissent comme une piste de financement
classique, réhabillée dans une rhétorique souverainiste. Ce n’est pas une
innovation – le mécanisme avait déjà été expérimenté par le passé par la
Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS). La véritable question n’est donc pas
leur nouveauté, mais leur soutenabilité et leur crédibilité.
L’argument de la solvabilité de l’État du Sénégal mérite d’être nuancé. Dans
un pays où le déficit budgétaire et l’endettement public sont déjà sous
pression, présenter l’État comme un créancier sûr relève davantage de la
promesse politique que de l’analyse économique. La comparaison avec la
France est éclairante : des millions d’épargnants y détiennent des obligations
publiques qui, en pratique, ne rapportent plus rien, leur rendement réel ayant
été rongé par l’inflation. L’épargnant sénégalais de la diaspora doit donc
s’interroger : son attachement patriotique suffit-il à justifier un placement qui
pourrait perdre sa valeur réelle demain ?
Le taux annoncé de 6 à 7 % paraît attractif comparé à l’épargne classique,
mais il doit être mis en regard du risque. Ce risque est double : financier,
compte tenu de la fragilité des finances publiques ; et politique, au vu de la
gouvernance parfois approximative de la dette. L’élan patriotique peut inciter
à souscrire, mais l’histoire économique prouve que la fibre du cœur ne
compense jamais la réalité des chiffres.
Le parallèle avec les obligations françaises l’illustre : massivement détenues
par les ménages via l’assurance-vie et les fonds de pension, elles ont été
vidées de leur substance par des décennies de taux artificiellement bas,
transformant une rente promise en illusion comptable. Le danger est que les
diaspora bonds sénégalais suivent le même chemin : séduisants au départ,
mais décevants sur la durée si la trajectoire macroéconomique n’est pas
corrigée. Les managers de ce système n’inspirent pas confiance.
Enfin, l’idée que ces emprunts financeraient directement des infrastructures
visibles, comme une autoroute ou un hôpital, est séduisante mais trompeuse.
La dette publique ne fonctionne pas comme une caisse affectée : elle se fond
dans un budget global, soumis à toutes sortes de contingences. La promesse
de « voir » son argent dans un projet précis relève davantage de la
communication que de l’économie réelle. Ces gros investissements sont en
général soutenus par des financements concessionnels.
En conclusion, les diaspora bonds peuvent diversifier les sources de
financement et flatter un sentiment de patriotisme économique. Mais pour ne
pas devenir les « obligations sans valeur » de demain, ils doivent être
adossés à une gouvernance rigoureuse, à une transparence accrue et à une
discipline budgétaire qui, pour l’instant, restent à démontrer.
Ibrahima Thiam, Président du parti ACT