SOCIOLOGIE DU POUVOIR:
Magistrats : avez-vous trahi la justice ?
Dédicace à monsieur Ousmane Diagne, ministre de la justice
Respect à monsieur Kéba Mbaye
Clin d'oeil à mon vieil ami Mayoro Mbaye!
J'appelle ici et sans détour les magistrats sénégalais, via cette dédicace, à réexaminer le sens de leur serment. Face aux dérives politiques et à la perte d’indépendance du pouvoir judiciaire qui gangrène le Sénégal, je sonne l’alarme en vous rappelant que : rendre justice, ce n’est pas exécuter des ordres ou suivre un agenda politique caché.
La justice ne saurait survivre longtemps lorsqu’elle cesse d’être le sanctuaire de l’impartialité et de la conscience nationale. Elle ne résiste pas à l’épreuve du temps lorsqu’elle se laisse transformer en théâtre d’ombres, où se rejouent les pièces écrites par les puissants. Le serment prêté par chaque magistrat au moment de son investiture est d’une clarté limpide : servir la nation, être loyal envers la loi, rendre justice sans considération de personne. Pourtant, dans le contexte actuel du Sénégal, il est permis de s’interroger : ce serment est-il resté un acte vivant ou n’est-il devenu qu’un rite de passage dénué de toute force morale ?
Il serait malhonnête de nier les avancées juridiques, les efforts de formation, les réformes institutionnelles. Mais ces progrès matériels restent impuissants face à la crise silencieuse qui ronge la magistrature sénégalaise : la perte de sa substance éthique. Lorsque le pouvoir judiciaire cesse de refléter les exigences morales de la nation, il devient un simple prolongement des volontés politiques, une épée sans poignée, une balance déséquilibrée, un théâtre d’injustice.
Dans le paradigme de la sociologie du pouvoir, la justice n’est pas un simple ensemble de procédures ou de textes. Elle est une institution de régulation symbolique. Elle participe à la reproduction des rapports de pouvoir. Quand elle est autonome, elle assure l’équilibre et la correction des dérives. Quand elle est capturée, elle devient le bras armé d’une domination politique ou sociale. Ce que nous vivons depuis quelques années au Sénégal, c’est cette captation progressive, insidieuse, normalisée de la magistrature par les centres de pouvoir exécutifs. Le Conseil Supérieur de la Magistrature, loin d’être une instance de protection de l’indépendance, est devenu un instrument de soumission. Il suffit d’observer les nominations, les sanctions, les récompenses : elles obéissent moins à des critères d’éthique qu’à des logiques de clientélisme politique.
Le drame n’est pas uniquement institutionnel. Il est aussi subjectif. Car la plus grande tragédie, ce n’est pas qu’un juge soit manipulé : c’est qu’il accepte de l’être sans même se sentir violenté. C’est qu’il trouve dans cette obéissance un confort, une ascension, une reconnaissance. Le pouvoir n’a plus besoin de contraindre : il cooptère. Il n’a plus besoin de réprimer : il séduit. Le juge devient alors complice volontaire. Or, dans toute société où la justice pactise avec les volontés dominantes, les droits des plus faibles deviennent abstraits. On ne juge plus, on exécute. On ne pèse plus le droit, on pèse les conséquences politiques de la décision.
Le peuple sénégalais ne croit plus en la justice. Il la redoute. Il l’évite. Il la vit comme une menace et non comme une protection. Cette perception n’est pas le fruit d’une manipulation médiatique. Elle est le résultat de centaines de cas d’arrestations abusives, de poursuites arbitraires, de verdicts incompréhensibles, de silences coupables. Le traitement répressif des opposants politiques, les incarcérations massives de jeunes manifestants, les décisions spectaculairement déséquilibrées dans des affaires politico-judiciaires ont installé un climat de méfiance. La justice ne parle plus la langue du peuple. Elle parle celle du pouvoir.
Or, une justice qui perd sa capacité d’être crue ne peut plus être entendue. Elle devient une mise en scène. Le magistrat se mue en comédien répétant les textes du procès sans pouvoir toucher l’âme du justiciable. La sociologie du pouvoir nous montre que ce décalage symbolique est la première phase de la délégitimation. Une institution cesse d’exister non pas lorsqu’elle est supprimée, mais lorsqu’elle n’est plus reconnue comme juste. Et il suffit que le peuple cesse de croire pour que tout le système bascule.
C’est à ce seuil que nous sommes. Et c’est ici que l’appel éthique doit retentir. Magistrats du Sénégal, vous n’êtes pas des instruments. Vous n’êtes pas des prolongements du pouvoir politique. Vous êtes des dépositaires de la souveraineté juridique. Lorsque vous rendez une décision, vous ne tranchez pas simplement entre deux parties : vous dites ce qu’est la norme, vous tracez les contours du juste, vous enseignez la légalité. Et le peuple regarde, observe, apprend. S’il ne voit que soumission, crainte, favoritisme, il en tire les conséquences morales : la justice est achetable, les verdicts sont prévisibles selon les affinités politiques, le pouvoir peut tout.
Mais ce fatalisme n’est pas irréversible. Il est encore temps de redonner du sens au serment. Il est encore possible de réhabiliter l’éthique dans la magistrature. Cela n’implique pas de héroïsme spectaculaire. Cela commence par de petites désobéissances internes, de modestes refus, de courageux silences, de sobres décisions. Dire non, même calmement, même dans le secret d’un délibéré. Refuser de suivre une consigne injuste. Délibérer en son âme et conscience plutôt qu’en fonction d’une stratégie de carrière. C’est par ces gestes minuscules que renaît une institution.
Le peuple sénégalais traverse une période de turbulence historique. Il interroge ses institutions, ses dirigeants, ses modèles. Il exige des comptes. Ce mouvement ne peut se contenter d’une mue politique. Il a besoin d’une mue judiciaire. La justice doit se remettre en question. Elle doit entendre la plainte sociale, sans devenir populiste. Elle doit sentir la colère des jeunes, sans perdre sa tempérance. Elle doit défendre l’État de droit, mais sans être instrumentalisée pour sauver des gouvernances déclinantes.
Il est temps, magistrats, d’être à la hauteur du serment. Non pas dans les mots, mais dans l’exercice quotidien. Non pas dans l’affichage, mais dans la discrétion d’un jugement équitable. La nation vous regarde. L’histoire vous jugera. Et vous-mêmes, un jour, vous vous demanderez si vous avez été le magistrat du pouvoir ou celui du peuple. Que votre conscience vous réponde en vérité.
Par Dr. Moussa Sarr
Sociologue, chercheur en communication publique et anticipateur.
Tenant de la thèse sur la convergence anticipatoire








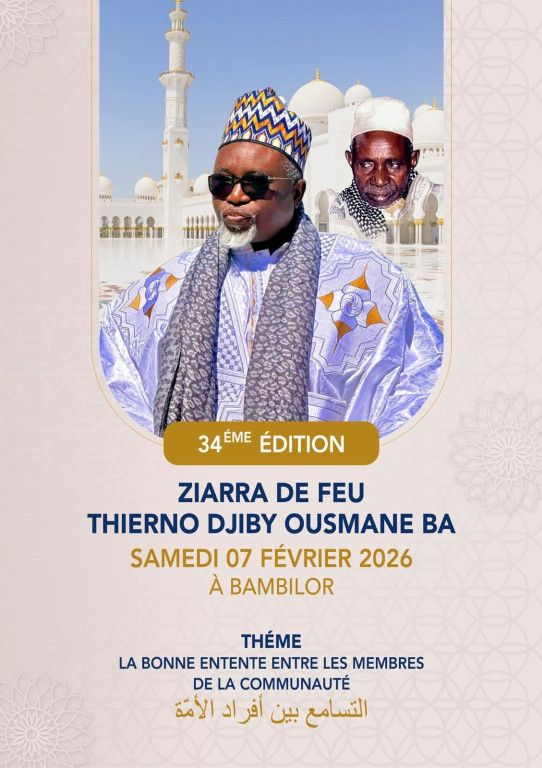
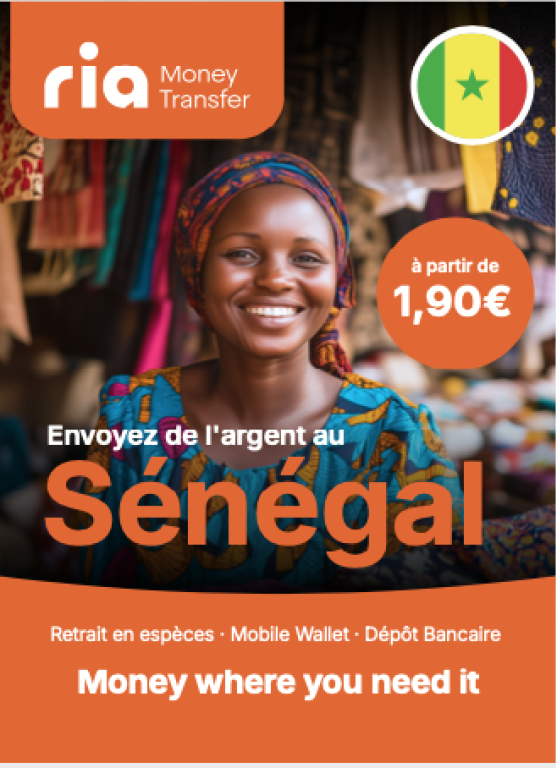

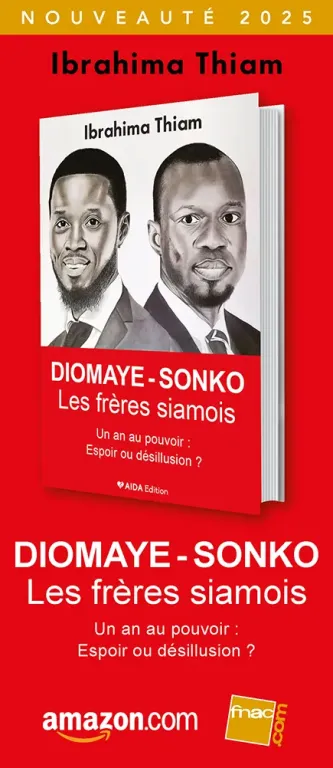

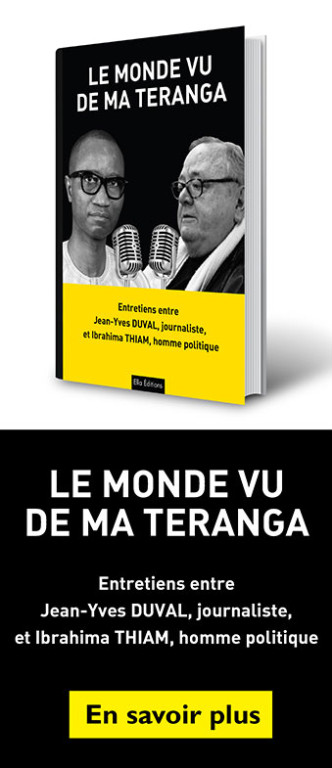

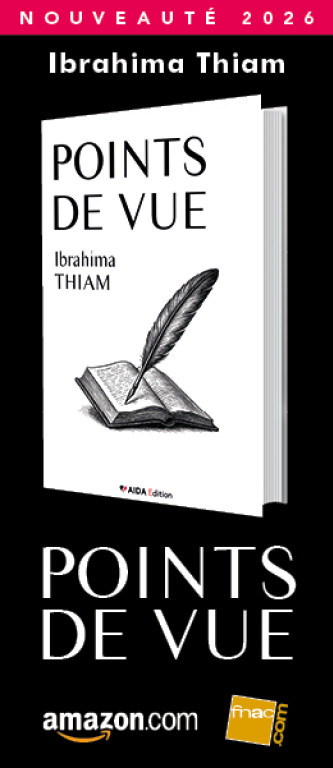
Le droit pénal est l'extréme ratio de toute société libre, démocratique et légalement juste et équitable