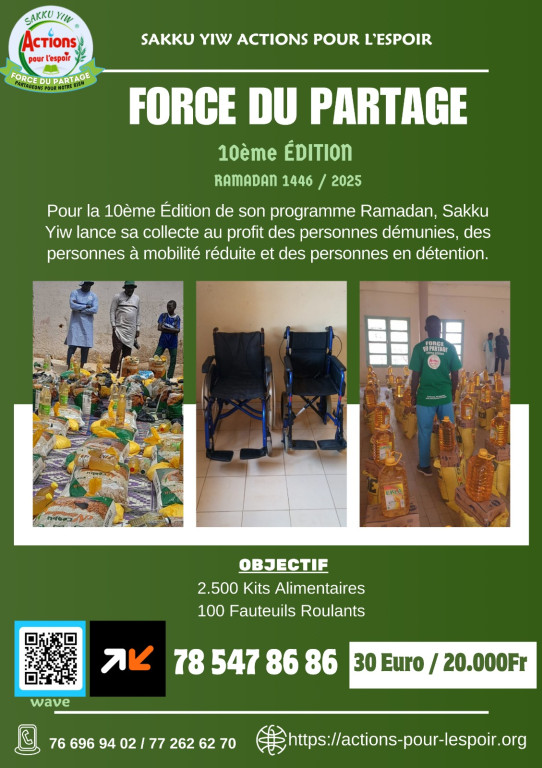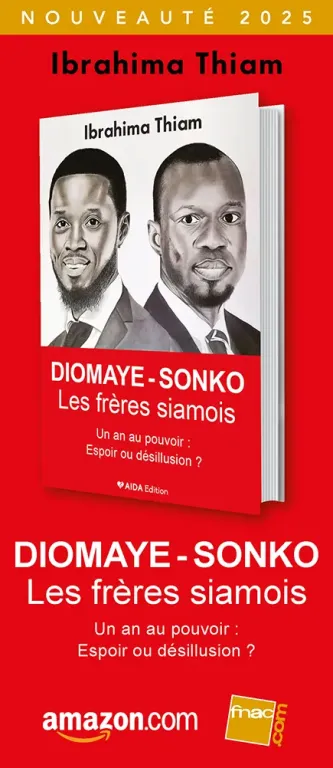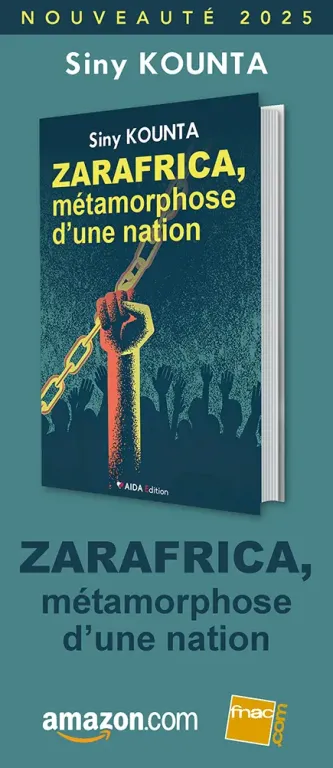Awa Ba de l'Association EFAPO (En Finir Avec la Polygamie) : “Nous accompagnons les femmes sur les plans administratif, juridique, psychologique et social”
Fondatrice de l'association EFAPO (En Finir Avec la Polygamie), Awa Ba s'impose comme une militante infatigable contre les violences faites aux femmes. Née au Sénégal, elle a bâti en France un engagement de terrain, porté par une expérience personnelle douloureuse et un désir inébranlable de justice. Dix ans après la création de son association, elle revient sur son parcours, ses combats et ses espoirs.
Vous êtes née au Sénégal, dans un contexte où la tradition est centrale. Comment votre parcours personnel at-il façonné votre regard sur la condition des femmes ?
J'ai grandi dans une famille polygame. Très jeune, j'ai été témoin de scènes de jalousie, de violences verbales, parfois physiques. Ces réalités m'ont été imposées par les coutumes, au nom d'un silence social difficile à briser. Mais j'ai compris tôt l'ampleur de cette injustice. À 15 ans, j'ai échappé à un mariage forcé avec un homme de l'âge de mon père. J'ai résisté par une grève de la faim. Ma sœur, elle, n'a pas eu cette chance. Son mariage polygame l'a détruite jusqu'à sa mort.
Ce personnel vécu est à l'origine de mon engagement. Mon livre Polygamie, la douleur des femmes témoigne de ces blessures, en mêlant récit intime et réflexion collective.
Vous avez une formation en puériculture. Comment ce métier at-il nourri votre combat ?
Depuis plus de quinze ans, je travaille en tant qu'auxiliaire de puériculture dans la fonction publique hospitalière. Si la naissance d'un enfant est souvent un moment de joie, j'ai aussi croisé des femmes détruites psychologiquement par la polygamie ou d'autres formes de violence. Les écouter, les soutenir, les orienter… Tout cela m'a renforcé dans mon combat. Ce métier m'a appris à écouter sans juger. Il a été une passerelle entre mon histoire intime et mon engagement public.
Pourquoi avoir écrit Polygamie, la douleur des femmes ? Comment l'ouvrage at-il été reçu ?
Je voulais briser le silence. Montrer les blessures invisibles : les humiliations, la solitude, la rivalité imposée entre coépouses, l'absence de reconnaissance affective. Ce livre donne la parole aux femmes qui souffrent dans l'ombre. Il a été bien accueilli par mon entourage, fier de voir quelqu'un oser dire tout haut ce que beaucoup taisent. Aujourd'hui, il est encore diffusé dans les salons et en ligne.
Comment est née votre association EFAPO ?
EFAPO a été fondée en novembre 2013, à la suite d'un événement tragique : la mort de ma sœur, victime d'un mariage polygame imposé. Ce jour-là, j'ai juré de me battre contre cette forme d'oppression. J'ai voulu témoigner à travers un livre, mais aussi créer une structure capable d'agir concrètement. EFAPO lutte contre la polygamie, les mariages forcés, l'excision, mais aussi contre toutes les violences faites aux femmes.
Quelles sont les missions concrètes d’EFAPO ?
Nous accompagnons les femmes sur les plans administratif, juridique, psychologique et social. Nous les soutenons dans les démarches (dépôt de plainte, hébergement d’urgence, accompagnement psychologique avec notre psychologue Antoine Molleron, aide juridique avec notre avocate Me Léa Nguessan, etc.).
Nous leur offrons aussi des outils pour reconstruire leur autonomie : ateliers d’insertion, apprentissage du français, accès au permis de conduire, etc. EFAPO, c’est aussi un espace de parole, de lien social, où les femmes peuvent se retrouver, échanger, reprendre confiance en elles.
Vous menez aussi des actions de sensibilisation. Pouvez-vous nous en parler ?
Nous intervenons dans les écoles, de la maternelle au lycée, mais aussi auprès des jeunes de l’EPIDE (18-25 ans), pour parler d’égalité femmes-hommes, de violences, de discriminations.
Nous luttons également contre la précarité à travers des distributions alimentaires ou de fournitures scolaires. Enfin, nous avons mis en place des ateliers de bien-être (cuisine, couture, potager, écriture, etc.) pour tisser des liens entre femmes et lutter contre l’isolement.
Quelles sont, selon vous, les plus grandes réussites d'EFAPO ?
Trois réussites me viennent à l'esprit :
1. La libération de la parole : des femmes osent parler, dénoncer ce qu'elles réalisent en silence.
2. L'accompagnement concret : nous avons aidé des centaines de femmes à sortir de la violence et à reconstruire leur vie.
3. La reconnaissance institutionnelle : nos actions ont permis de sensibiliser les institutions, les médias et le grand public.
Assiste-t-on aujourd'hui à une évolution réelle de la société ?
Oui et non. Il y a une libération de la parole, c'est indéniable. Les femmes osent davantage parler. Mais les structures pour les accueillir et les protéger restent insuffisantes. Beaucoup vivent encore dans le silence et la peur. Le combat est loin d’être terminé.
Quels jouent les soutiens publics et privés dans votre travail ?
Ils sont essentiels. Grâce à eux, nous avons pu renforcer nos équipes, structurer nos actions et mener des projets plus ambitieux. Ces appuis nous donnent de la visibilité, de la légitimité, et surtout la possibilité d'avoir un impact durable.
Vous souhaitez que « les femmes africaines, et en particulier sénégalaises, goûtent enfin à la liberté de choisir leur vie ». Que signifie cette liberté ?
C'est la liberté de dire non. De choisir son partenaire. D'exprimer ce que l'on ressent sans peur. D'être autonome financièrement. Une femme qui travaille, qui est formée, qui parle français, peut sortir d'une relation toxique et élever ses enfants dans la dignité. C'est cette liberté que nous voulons garantir.
Vous avez été décoré par l'État français. Que représente cette distinction ?
J'ai reçu la distinction de Chevalier de l'ordre national du mérite. C'est un honneur, bien sûr, mais aussi une reconnaissance pour toutes ces femmes dont je porte la voix. C'est une victoire collective. Chaque femme que nous avons aidée, chaque silence brisé, chaque histoire racontée a contribué à cette reconnaissance.
Quels sont vos projets futurs ?
Je souhaite poursuivre mon engagement, continuer à écrire, à sensibiliser. Pour EFAPO, nous visons la création d'un centre d'accueil pour femmes en détresse. Un lieu d'écoute, de soins, de reconstruction. Et pour moi-même voix, je veux continuer à être cette, forte, libre et debout, qui refuse l'inacceptable.
Propos recueillis par
Malick Sakko